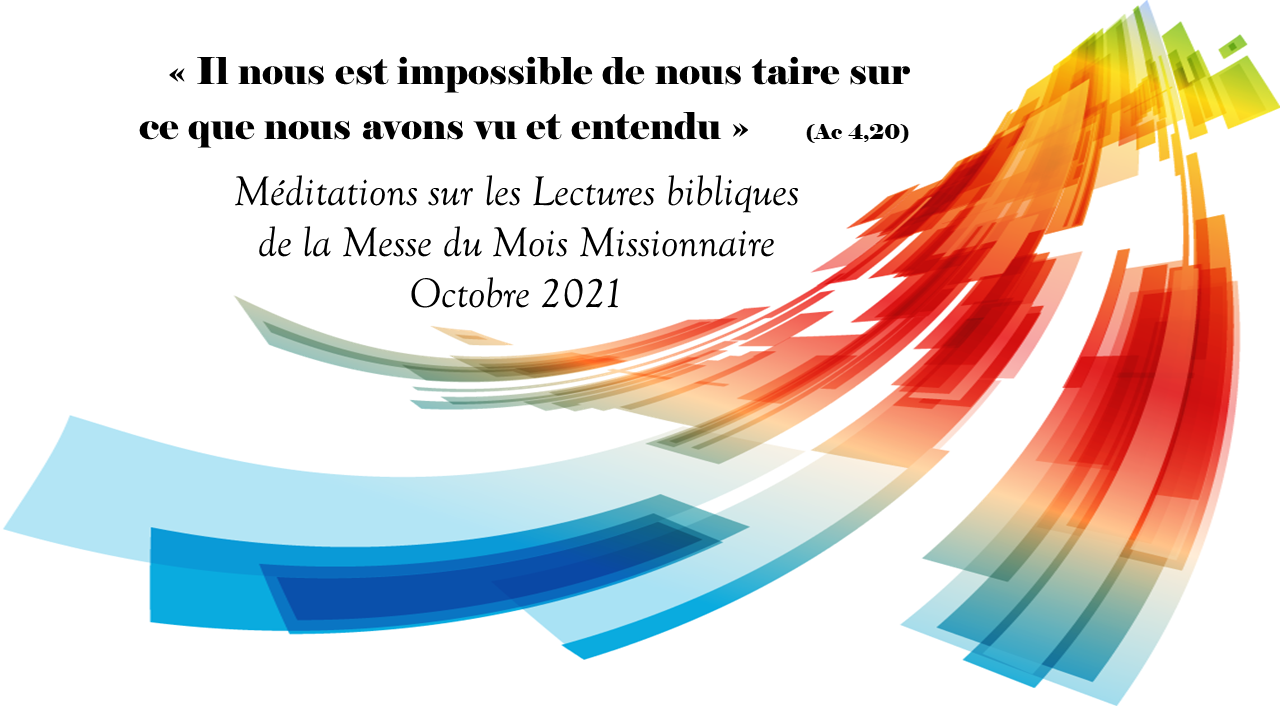
29 octobre 2021 - Vendredi, 30ème semaine du Temps ordinaire
Rm 9, 1-5
Ps 147
Lc 14, 1-6
Frères, c’est la vérité que je dis dans le Christ, je ne mens pas, ma conscience m’en rend témoignage dans l’Esprit Saint : j’ai dans le cœur une grande tristesse, une douleur incessante.
Moi-même, pour les Juifs, mes frères de race, je souhaiterais être anathème, séparé du Christ : ils sont en effet israélites, ils ont l’adoption, la gloire, les alliances, la législation, le culte, les promesses de Dieu ; ils ont les patriarches, et c’est de leur race que le Christ est né, lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni pour les siècles. Amen.
La douleur et la souffrance continuelles de Paul vis-à-vis de son peuple sont bien compréhensibles : il appartient à la descendance d’Israël, à la tribu de Benjamin, il est juif, fils de juifs, pharisien quant à la loi (cf. Ph 3, 5). Les Israélites sont ses frères selon la chair et son désir le plus fort est qu’ils le deviennent aussi selon l’Esprit. Ils sont déjà fils adoptifs de Dieu, qui les a choisis, a passé une alliance avec eux, leur a donné les promesses, la Loi et le Temple. Ce qu’ils ont reçu gratuitement aurait dû les conduire au Christ, qui est l’accomplissement de tout. Paradoxalement, Paul exprime son affliction en disant qu’il voudrait être séparé du Christ à leur profit.
Dans le psaume responsorial, le psalmiste aussi reconnaît les privilèges dont Dieu a enrichi son peuple : il l’a défendu, l’a béni, l’a fait vivre en paix, l’a rassasié à sa faim. Surtout, il a annoncé à Israël – et uniquement à Israël - sa parole, ses décrets et ses jugements.
Glorifie le Seigneur, Jérusalem ! Célèbre ton Dieu, ô Sion ! Il a consolidé les barres de tes portes, dans tes murs il a béni tes enfants. Il fait régner la paix à tes frontières, et d’un pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre : rapide, son verbe la parcourt.
Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qu’il ait ainsi traité, nul autre n’a connu ses volontés.
L’Évangile sonne comme un reproche à ce peuple, à ses docteurs de la Loi et aux pharisiens, qui auraient dû comprendre que les dons par lesquels Dieu a comblé Israël n’avaient certes pas été donnés pour qu’il occupe la première place parmi les autres peuples de la terre, mais pour faire de lui le témoin et le messager de l’amour de Dieu pour tous les hommes. Au contraire, le peuple élu s’est enfermé dans une multitude de prescriptions mineures et de défenses de minuties légales, qui lui ont fait oublier, non seulement l’essentiel, mais aussi le sens commun de la compassion et de la solidarité. Si un enfant ou un bœuf tombent dans un puis un jour de sabbat, ne se hâte-t-on pas de l’en sortir ? L’interdiction de guérir un pauvre homme souffrant le jour du sabbat n’est-elle donc pas ridicule ? Les miracles de Jésus le jour du sabbat n’attentent certainement pas à la sacralité du jour sacré, mais visent à mettre à la première place le commandement de l’amour de Dieu et du prochain.
Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d’un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers l’observaient. Or voici qu’il y avait devant lui un homme atteint d’hydropisie.
Prenant la parole, Jésus s’adressa aux docteurs de la Loi et aux pharisiens pour leur demander : “ Est-il permis, oui ou non, de faire une guérison le jour du sabbat ? ”. Ils gardèrent le silence. Tenant alors le malade, Jésus le guérit et le laissa aller.
Puis il leur dit : “ Si l’un de vous a un fils ou un bœuf qui tombe dans un puits, ne va-t-il pas aussitôt le retirer, même le jour du sabbat ? ”. Et ils furent incapables de trouver une réponse.
Aujourd’hui encore, dans nos sociétés super technicisées, les épisodes d’attachement à des pratiques d’exclusion pour les motifs les plus divers, sociaux, culturels, religieux, non justifiés, ne manquent pas. Il est douloureux de constater, par exemple, que la coexistence entre des personnes de race différente, surtout en Afrique et en Amérique, a donné lieu à tant d’injustices et de discriminations, légalisées pratiquement jusqu’à nos jours : aux États-Unis les écoles publiques n’ont été ouvertes à tous, sans discrimination de race, qu’en 1954. En Afrique du Sud, l’apartheid – la séparation raciale – n’a pris fin qu’avec l’élection du président Nelson Mandela en 1994.
Cependant, il y eut toujours des hommes et des femmes qui, dans l’Église, aimèrent le Christ avec le même amour que saint Paul et luttèrent contre les injustices par amour de leurs frères persécutés et opprimés, vilipendés et méprisés, étant eux-mêmes à leur tour persécutés et entravés de mille façons : Katharine Mary Drexel (États-Unis d’Amérique - USA) en est un exemple.
Tiraillée entre l’ardent désir de se consacrer à Dieu dans la vie contemplative et la mission en faveur des natifs indiens et afro-américains, elle laissait perplexe son directeur spirituel, le p. O’Connor. Elle obéit enfin à la voix de l’Église, qui lui parlait à travers son Pasteur : de fait, elle avait eu l’occasion d’être reçue en audience par le Pape Léon XIII durant un voyage en Europe. Elle racontera elle-même cet épisode :
À genoux à ses pieds, dans mon imagination enfantine je pensais que sûrement le Vicaire du Christ ne m’aurait pas dit non. Aussi l’ai-je supplié d’envoyer des prêtres missionnaires pour les Indiens de l’évêque. À ma grande stupeur, Sa Sainteté me répondit : “ Ma fille, et pourquoi ne deviens-tu pas, toi, une missionnaire ? ” (American Dream. In viaggio con i santi americani, M. S. Caesar (cur.), P. Rossotti (cur.), Marietti 1820, Genova 2016, p. 183) [Notre traduction].
C’est ainsi que cette milliardaire américaine, avec ses grands désirs qui demeuraient toujours vagues et imprécis, fonda en 1891 la Congrégation des Sœurs du Saint-Sacrement pour les Indiens et Noirs. Elle travailla inlassablement pendant soixante ans et parvint à fonder, bien qu’en affrontant d’énormes difficultés, 145 missions parmi les Indiens, 50 écoles pour les Afro-américains, 12 écoles pour les Indiens et 49 couvents. En 1917, elle fonda la Xavier’s School à New Orleans, qui fut transformée en université en 1932 et devint la prestigieuse Xavier University.
Le 26 septembre 2015, le Pape François célébra la messe avec les évêques, les prêtres et les religieux de Pennsylvanie dans la cathédrale de Philadelphie. Durant l’homélie, il évoqua les débuts de la vocation de sainte Katharine Mary Drexel par ces mots :
La plupart d’entre vous connaissent l’histoire de sainte Catherine Drexel, l’une des grandes saintes issues de cette Église locale. Quand elle a fait part au Pape Léon XIII des besoins des missions, le Pape – c’était un Pape très sage – lui a demandé exprès : ‘‘Et toi ? Que vas-tu faire ?’’. Ces paroles ont changé la vie de Catherine, parce qu’elles lui ont rappelé, qu’après tout, chaque chrétien ou chrétienne, en vertu du baptême, a reçu une mission. Chacun de nous doit répondre, de son mieux, à l’appel du Seigneur pour bâtir son Corps, l’Église.
‘‘Et toi ?’’. Je voudrais m’arrêter sur deux aspects de ces mots dans le contexte de notre mission spécifique de transmettre la joie de l’Évangile et d’édifier l’Église, que nous soyons prêtres, diacres ou membres - hommes et femmes - d’instituts de vie consacrée.
En premier lieu, ces paroles – ‘‘Et toi ?’’ – ont été adressées à une jeune personne, à une jeune femme ayant de hauts idéaux, et elles ont changé sa vie. Elles lui ont fait penser à l’immense tâche à accomplir, et l’ont conduite à réaliser qu’elle était appelée à y prendre part. Que de jeunes gens dans nos paroisses et dans nos écoles ont les mêmes hauts idéaux, la même générosité d’esprit et le même amour pour le Christ ainsi que pour l’Église ! Je vous pose la question : leur lançons-nous le défi ? Leur accordons-nous une place et les aidons-nous à accomplir leur mission ? Trouvons-nous la manière dont ils peuvent partager leur enthousiasme et leurs dons avec nos communautés, surtout à travers des œuvres de charité et le souci des autres ? Partageons-nous notre joie et notre enthousiasme au service du Seigneur ?
L’un des plus grands défis auquel l’Église est confrontée en ce moment est d’encourager chez tous les fidèles le sens de la responsabilité personnelle dans la mission de l’Église, et à les préparer pour qu’ils puissent assumer cette responsabilité en tant que disciples missionnaires, en tant que levain de l’Évangile dans notre monde. Cela demande de la créativité pour s’adapter aux changements de situation, en transmettant l’héritage du passé non pas seulement en maintenant les structures et les institutions, qui sont utiles, mais surtout en s’ouvrant aux possibilités que l’Esprit nous révèle et en communiquant la joie de l’Évangile, jour après jour et à toutes les étapes de notre vie.
‘‘Et toi ?’’. Il est significatif que ces paroles d’un Pape âgé aient été adressées à une fidèle laïque. Nous savons que l’avenir de l’Église, dans une société en évolution rapide, appelle d’ores et déjà un engagement plus actif des laïcs. L’Église aux États-Unis a toujours consacré un immense effort à la catéchèse et à l’éducation. Notre défi, aujourd’hui, est de construire sur ces fondations solides et d’encourager un sens de la collaboration et de la responsabilité partagée dans la planification de l’avenir de nos paroisses et de nos institutions. Cela ne signifie pas renoncer à l’autorité spirituelle dont nous avons été investis ; mais plutôt, cela signifie discerner et employer avec sagesse les multiples dons que l’Esprit répand sur l’Église. En particulier, cela signifie évaluer l’immense contribution que les femmes, laïques et religieuses, ont apportée et continuent d’apporter dans la vie de nos communautés.

