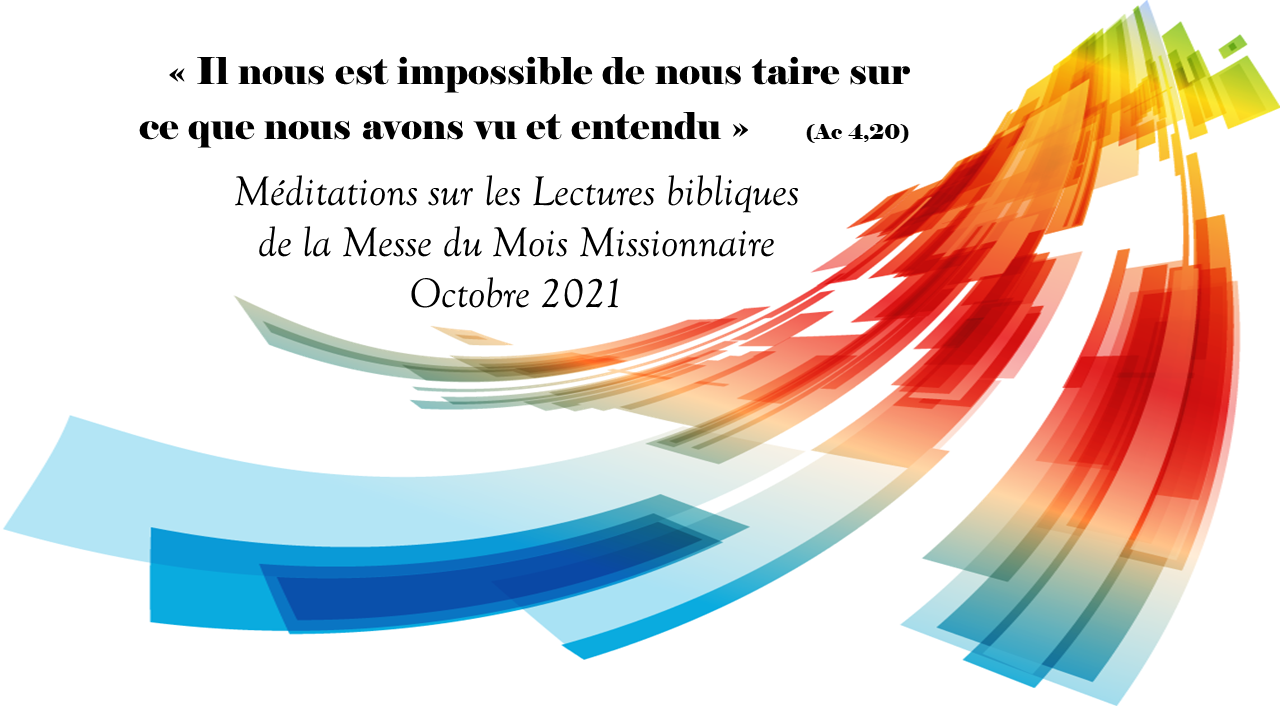
26 octobre 2021 - Mardi, 30ème semaine du Temps ordinaire
Rm 8, 18-25
Ps 125
Lc 13, 18-21
Frères, j’estime qu’il n’y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu.
Car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l’a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l’espérance d’être, elle aussi, libérée de l’esclavage de la dégradation, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu.
Nous le savons bien, la création tout entière gémit, elle passe par les douleurs d’un enfantement qui dure encore. Et elle n’est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons ; nous avons commencé à recevoir l’Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps.
Car nous avons été sauvés, mais c’est en espérance ; voir ce qu’on espère ce n’est plus espérer : ce que l’on voit, comment peut-on l’espérer encore ? Mais nous, qui espérons ce que nous ne voyons pas, nous l’attendons avec persévérance.
Dans le passage de la lettre aux Romains de ce jour, saint Paul nous offre un cadre précis du monde racheté par le Christ et nous présente, avec un réalisme extrême, mais aussi avec espérance, la condition actuelle de l’homme et de toute la création.
Bien que sauvé, bien qu’ayant été fait fils de Dieu, l’homme vit dans la douleur, dans l’attente d’un accomplissement non encore atteint. Nous avons reçu l’Esprit Saint, mais seulement comme caution ; nous possédons les prémisses de l’Esprit, non la plénitude, et notre corps n’a pas encore été totalement racheté. Toute la création participe aussi à cette souffrance et à cette attente, par la faute de l’homme qui, par le péché, l’a faite entrer dans l’esclavage de la corruption.
Mais, dit saint Paul, l’homme et la création, dans cet état de caducité et de douleur, vivent non pas une mort, mais une gestation en vue de l’enfantement. Celle-ci comporte naturellement angoisse et souffrance, mais elle va vers la vraie vie : l’homme et la création tendent à la gloire qu’ils ne voient pas encore, mais qu’ils attendent de voir. Les conditions pour voir ce qui ne se voit pas encore consistent à l’attendre avec espérance et avec persévérance.
Et le psaume responsorial offre tout de suite un exemple de renaissance, même s’il ne s’agit pas encore d’un bonheur complet, car nous sommes encore sur la terre. Les déportés de Babylone, bien qu’en petit nombre et au milieu de graves difficultés, sont revenus libre sur leur terre ! « Nous étions comme en rêve », dit le psalmiste. Le Seigneur sait que ses créatures ne peuvent pas vivre sans joie, même fragile et provisoire, et dans sa tendresse il tempère les épreuves de l’exil enduré. Il nous met à l’épreuve, il teste notre fidélité, il veut que nous lui témoignions l’espérance et la persévérance, mais il ne nous fait manquer ni de grandes joies après des périodes de souffrances aiguës, ni de petites joies quotidiennes qui nous permettent d’avancer heureux, même au milieu des tribulations :
Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve ! Alors notre bouche était pleine de rires, nous poussions des cris de joie. Alors on disait parmi les nations : “ Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! ”. Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert. Qui sème dans les larmes moissonne dans la joie. Il s’en va, il s’en va en pleurant, il jette la semence ; il s’en vient, il s’en vient dans la joie, il rapporte les gerbes.
L’Évangile du jour est singulièrement en harmonie avec l’épître et le psaume : il nous offre beaucoup de confiance et d’espérance.
En ce temps-là, Jésus disait : “ À quoi le règne de Dieu est-il comparable, à quoi vais-je le comparer ? Il est comparable à une graine de moutarde qu’un homme a prise et jetée dans son jardin. Elle a poussé, elle est devenue un arbre, et les oiseaux du ciel ont fait leur nid dans ses branches ”. Il dit encore : “ À quoi pourrai-je comparer le règne de Dieu ? Il est comparable au levain qu’une femme a pris et enfoui dans trois mesures de farine, jusqu’à ce que toute la pâte ait levé ”.
L’image du royaume de Dieu que nous offre saint Luc est simple et familière, au point de n’effrayer personne. Le règne de Dieu est comparable à une graine de moutarde … Il est comparable au levain … La graine de moutarde et le levain sont de petites choses, à notre portée, et pourtant ils possèdent en eux une force extraordinaire, qui ne vient certainement pas de nous. Nous avons la capacité et la responsabilité de bien utiliser ces éléments, de les faire servir l’objectif pour lequel Dieu les a créés : semer la graine dans notre jardin ou mélanger le levain dans notre farine pour la croissance du royaume de Dieu. Nous sommes nous, mais c’est la grâce de Dieu qui fait grandir, sans que nous sachions comment. « La mystérieuse fécondité de la mission ne consiste pas dans nos intentions, dans nos méthodes, dans nos élans et dans nos initiatives, mais elle repose précisément dans ce vertige : le vertige que l’on ressent devant les paroles de Jésus, quand il dit : “ sans moi vous ne pouvez rien faire ” ». (Pape François, Sans Jésus nous ne pouvons rien faire : être missionnaire aujourd'hui dans le monde [Notre traduction]).
Le royaume de Dieu grandit en nous, à condition toutefois que nous prenions conscience de notre pauvreté et de l’incapacité de nous sauver tout seuls. Le Christ, par sa vie, sa mort et sa résurrection, nous a sauvés : nous devons seulement le croire, l’espérer et offrir notre petite collaboration à ce salut, que nous ne voyons pas encore dans sa totalité. Adorons l’initiative et le don que nous recevons et agissons avec confiance en faisant tout ce que nous pouvons faire, même si c’est peu. Et cherchons à être reconnaissants pour la miséricorde dont nous sommes l’objet de la part de Dieu.
Notre collaboration à la grâce est toujours une œuvre missionnaire, c’est même la seule œuvre véritablement missionnaire, car le témoignage de la vie est la forme d’apostolat la plus convaincante. Et cela spécialement si le témoignage est lié à une grande souffrance, vécue avec amour, et même avec joie et le sourire aux lèvres.
C’est ce qui est advenu à une sainte libanaise, Rafqa Choboq Ar-Rayes, morte en 1914 et canonisée par le Pape Jean-Paul II le 10 juin 2001 :
En canonisant la Bienheureuse Rafqa Choboq Ar-Rayès, l'Église met en lumière d'une manière toute particulière le mystère de l'amour donné et accueilli pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Cette moniale de l'Ordre libanais maronite désirait aimer et donner sa vie pour ses frères. Dans les souffrances qui n'ont cessé de la tourmenter durant les vingt-neuf dernières années de son existence, sainte Rafqa a toujours manifesté un amour généreux et passionné pour le salut de ses frères, puisant dans son union au Christ, mort sur la croix, la force d'accepter volontairement et d'aimer la souffrance, authentique voie de sainteté.
Puisse sainte Rafqa veiller sur ceux qui connaissent la souffrance, en particulier sur les peuples du Moyen-Orient confrontés à la spirale destructrice et stérile de la violence ! Par son intercession, demandons au Seigneur d'ouvrir les cœurs à la recherche patiente de nouvelles voies pour la paix, hâtant les jours de la réconciliation et de la concorde !
(Chapelle papale pour la canonisation de 5 bienheureux, Homélie de Jean-Paul II, Solennité de la Sainte Trinité, 10 juin 2001)
En raison d’un long cycle d’aveuglement et de paralysie totale, il ne nous reste pas d’écrits de cette humble moniale, compatriote et contemporaine du célèbre thaumaturge saint Charbel Makhlouf.
Elle était d’abord entrée dans une Congrégation de vie apostolique et envoyée comme enseignante dans les villages de montagne ; ce n’est que par la suite qu’elle était devenue moniale contemplative dans le même Ordre que saint Charbel.
Sainte Rafqa avait vécu son enfance et son adolescence pendant la guerre civile et les divisions qui avaient appauvri les familles libanaises de 1840 à 1845, mais elle avait souffert de l’extermination des maronites de 1860, durant laquelle les enfants étaient arrachés aux bras de leurs mères et tués. La sainte put sauver un enfant, en le cachant dans son habit et en le défendant ainsi de la cruauté et de la barbarie de ceux qui le suivaient. Elle demeura toujours si perturbée par ces massacres qu’elle s’émouvait chaque fois que quelqu’un lui en parlait.
Passée en 1871 de la Congrégation des Mariamites de Bikfaya, qui avait été dissoute, à l’Ordre libanais des Moniales Maronites, elle désira s’unir davantage aux souffrances du Christ en lui demandant de participer à sa passion. C’est ce qui advint. Elle perdit un œil durant une opération et devint définitivement aveugle par la suite. Tout son corps se paralysa, à l’exception de ses mains, qui lui permirent de tricoter pendant toute sa vie. Elle vécut jusqu’à l’âge de 82 ans, gardant toujours le sourire aux lèvres, dans une joie parfaite.
Après sa mort, le même phénomène se produisit sur sa tombe que celui qui s’était produit sur celle de saint Charbel : une lumière resplendissante brillait puis disparaissait. Certaines personnes des villages voisins du monastère Saint-Joseph de Jrapta virent ce prodige et en rendirent témoignage.
Le message de sainte Rafqa, pour tout chrétien qui se trouve dans la douleur, est un encouragement à la patience et à l’acceptation joyeuse de la souffrance par amour du Christ et du prochain, selon le dicton qui affirme que celui qui cherche Jésus-Christ sans la croix trouvera la croix sans Jésus- Christ et il trouvera pénible, voire impossible, de la porter. Rafqa nous enseigne qu’avec le Christ et par Lui, la Croix et les multiples souffrances de la vie deviennent prière et joie et sont la forme d’évangélisation la plus efficace.

