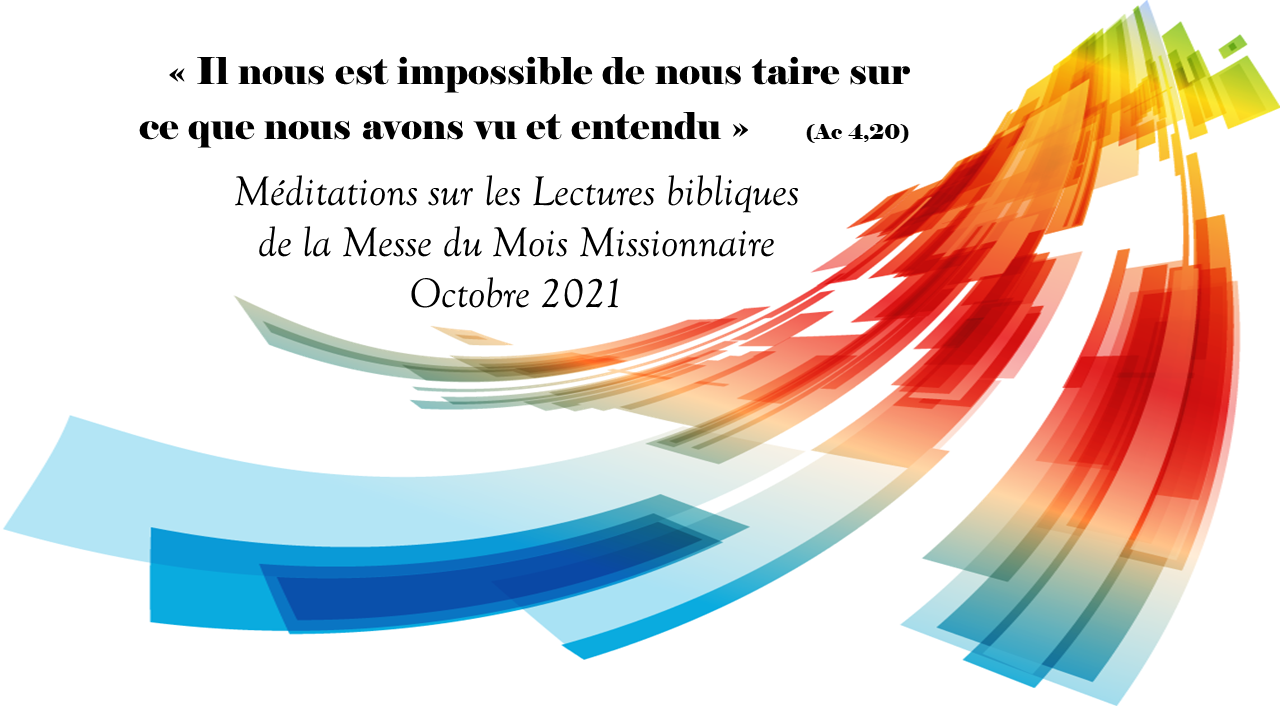
4 octobre 2021, Mémoire de saint François d’Assise
Lundi, 27ème semaine du Temps ordinaire
Jon 1, 1-2, 1.11
Jon 2, 3-5.8
Lc 10, 25-37
Aujourd’hui commence la lecture du prophète Jonas, qui se poursuivra les deux prochains jours, nous permettant de connaître ce petit livre en entier. Il s’agit d’un écrit didactique, plein d’ironie vis-à-vis du prophète et riches en réflexions universalistes qui constituent un sommet dans les écrits de l’Ancien Testament. Quant à l’Évangile, il nous rapporte la très belle parabole du bon Samaritain.
Ces deux textes, bien qu’ayant été écrits à des époques totalement différentes, présentent certains traits communs : ils critiquent la vision théologique restreinte de la classe religieuse dominante, affirment avec clarté en quoi consiste la vraie religion et témoignent de l’universalité du salut.
Le Seigneur Jésus a envoyé ses Apôtres à toutes les personnes, à tous les peuples et en tous lieux de la terre. Dans la personne des Apôtres, l’Église a reçu une mission universelle, qui ne connaît pas de limites et concerne le salut dans toute sa richesse selon la plénitude de vie que le Christ est venu nous apporter (cf. Jn 10, 10) : elle a été “ envoyée pour révéler et communiquer l’amour de Dieu à tous les hommes et à tous les peuples de la terre ”. Cette mission est unique, car elle a une seule origine et une seule finalité, mais elle comporte des tâches et des activités diverses. Tout d’abord, il y a l’activité missionnaire que nous appelons la mission ad gentes, par allusion au décret conciliaire ; il s’agit d’une activité primordiale de l’Église, une activité essentielle et jamais achevée. En effet, l’Église “ ne peut esquiver la mission permanente qui est celle de porter l’Évangile à tous ceux — et ils sont des millions et des millions d’hommes et de femmes — qui ne connaissent pas encore le Christ rédempteur de l’homme. C'est la tâche la plus spécifiquement missionnaire que Jésus ait confiée et confie de nouveau chaque jour à son Église ” (Jean-Paul II, Redemptoris Missio, n° 31, 7 décembre 1990).
Les deux textes bibliques de Jonas et de l’Évangéliste Luc, empreints de l’universalité de la miséricorde divine, sont remplis de mouvement et de mission, de fuites, de voyages, de retours, de contrastes entre celui qui fait la volonté de Dieu et celui qui préfère la sienne.
La parole du Seigneur fut adressée à Jonas, fils d’Amittaï : “ Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, et proclame que sa méchanceté est montée jusqu’à moi ”. Jonas se leva, mais pour s’enfuir à Tarsis, loin de la face du Seigneur (Jon 1,1-3).
Jonas s’oppose à la volonté salvifique de Dieu : il sait que le Seigneur regardera favorablement les gestes d’humiliation des habitants de Ninive, qui pourtant n’appartiennent pas au peuple élu et sont pécheurs. Dieu finira par leur pardonner au premier signe de leur repentance. Jonas n’est pas du tout d’accord avec cette miséricorde, qu’il estime être une faiblesse. Il cherche donc à fuir à Tarsis, aux frontières les plus reculées du monde alors connu, pensant de la sorte pouvoir échapper à la volonté du Seigneur. Plusieurs événements s’enchaînent alors : une tempête éclate, les marins sont saisis d’effroi, ils procèdent à un tirage au sort pour savoir qui est le responsable de ce malheur, et arrive la confession de Jonas. Comparés à Jonas, les marins apparaissent comme étant profondément religieux et bien décidés à suivre, non pas leur volonté, mais celle du Seigneur :
Les matelots ramèrent pour regagner la terre, mais sans y parvenir, car la mer était de plus en plus furieuse autour d’eux. Ils invoquèrent alors le Seigneur : “ Ah ! Seigneur, ne nous fais pas mourir à cause de cet homme, et ne nous rends pas responsable de la mort d’un innocent, car toi, tu es le Seigneur : ce que tu as voulu, tu l’as fait ”. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent à la mer. Alors la fureur de la mer tomba. Les hommes furent saisis par la crainte du Seigneur ; ils lui offrirent un sacrifice accompagné de vœux. Le Seigneur donna l’ordre à un grand poisson d’engloutir Jonas. Jonas demeura dans les entrailles du poisson trois jours et trois nuits. Alors le Seigneur parla au poisson, et celui-ci rejeta Jonas sur la terre ferme (Jon 1, 13-2, 1.11).
Ni la mer, ni le gros poisson ne supportent la rudesse du prophète désobéissant : sur l’ordre de Dieu, au bout de trois jours, ils le rejettent sur la plage. Nous savons bien que le Seigneur Jésus n’a pas peur de s’approprier cet épisode romanesque pour en faire le signe de sa descente aux enfers et de sa résurrection (Cf. Mt 12, 39-40).
L’auteur sacré, faisant survivre Jonas et le préparant pour d’autres actions denses de grands enseignements, peut intercaler dans son récit un merveilleux cantique poétique d’action de grâces.
Le psaume responsorial de la célébration de la Parole de ce jour nous offre plusieurs versets de ce cantique du prophète qui, angoissé et repenti, invoque Dieu du profond de l’abîme marin et est entendu du Seigneur :
Dans ma détresse, je crie vers le Seigneur et lui me répond ; du ventre des enfers j’appelle : tu écoutes ma voix. Tu m’as jeté au plus profond du cœur des mers, et le flot m’a cerné ; tes ondes et tes vagues ensemble ont passé sur moi. Et je dis : me voici rejeté de devant tes yeux ; pourrai-je revoir encore ton temple saint ? Quand mon âme en moi défaillait, je me souvins du Seigneur ; et ma prière parvint jusqu’à toi dans ton temple saint.
L’Évangile aussi comporte des scènes qui expriment beaucoup de mouvement, symbole du chemin de notre vie terrestre : un homme descend de Jérusalem à Jéricho ; les brigands l’attaquent et le laissent à demi-mort ; le prêtre et le lévite, en voyage eux aussi, passent outre ; un Samaritain, qui descendait par la même route, secourt le blessé, le mène à une auberge et repart, en promettant de revenir. Dans ce voyage – nous l’avons déjà vu à propos de Jonas – il y a des épisodes et des rencontres qui peuvent nous faire comprendre le véritable sens de la vie et de notre lien avec Dieu et avec les frères.
Dans le passage évangélique, à trois reprises on voit apparaître une critique ouverte à l’égard des guides religieux du peuple : au début c’est un docteur de la loi qui, « pour mettre Jésus à l’épreuve », l’interroge sur ce qu’il doit faire pour avoir la vie éternelle, puis, « voulant se justifier », lui demande : « Et qui est mon prochain ? ». La parabole racontée par Jésus se poursuit avec un prêtre et un lévite qui, probablement pour ne pas être contaminés par le sang d’un pauvre blessé, manquent à leur devoir précis de le secourir et négligent le véritable cœur de la Loi pour obtempérer à des règles de pureté moins importantes et caduques. Au centre du récit se trouve la figure du Samaritain, lui aussi en voyage pour ses affaires qui, éprouvant de la compassion, secourt le malheureux tombé aux mains des brigands, lave ses plaies, le charge sur sa monture et le conduit à l’auberge, en payant l’aubergiste et en le confiant à ses soins, lui promettant de payer les dépenses à son retour pour compenser ses attentions envers le blessé. C’est un Samaritain, donc un étranger, un homme considéré comme un hérétique par les Judéens.
La question spécieuse du docteur de la Loi : « Et qui est mon prochain ? » indique que, dans son esprit et dans son cœur, il existe une nette distinction entre prochains et lointains, coreligionnaires ou non, comme du reste dans la mentalité religieuse commune de l’époque. Jésus répond en renversant la question : c’est toi qui dois te faire le prochain de quiconque est dans le besoin, sans considérer qui est proche de toi par la race, la religion ou la culture. Si tu te fais le prochain de l’autre, indéniablement il deviendra un “ prochain ” pour toi.
Après ce renversement si clair et précis, Jésus envoie le docteur de la Loi en mission, comme Dieu l’avait fait avec Jonas : « Va, et toi aussi, fais de même ».
De nombreux Pères de l’Église ont vu dans la figure du Samaritain le Christ qui soigne les plaies de l’humanité, provoquées par le péché et qui se fait le prochain de notre misère et de notre malheur. L’auberge où il transporte l’humanité blessée est l’Église, qui poursuit son œuvre de salut grâce à la prédication et aux sacrements. Chaque chrétien est appelé à prendre part à l’action salvifique de l’Église, en collaborant au salut de ceux qui, proches ou lointains, ont besoin de secours spirituel et matériel, d’aide fraternelle, d’amour et de proximité.
Nous faisons mémoire aujourd’hui de saint François d’Assise, le frère universel, le saint sans doute le plus semblable au Christ, qui, par son témoignage de douceur, d’amour et de pauvreté, a opéré une transformation profonde dans la société et dans l’Église de son temps et de tous les temps.
Les sources franciscaines nous offrent de nombreuses phrases de François qui peuvent commenter les textes que nous venons de méditer et nous offrir des idées sur la façon d’offrir la richesse de l’Évangile à nos frères, proches et lointains, par les paroles et par les œuvres :
Qu’ils sont heureux et bénis ceux qui aiment le Seigneur et font ce que dit le Seigneur lui-même dans l’Évangile : “ Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, et ton prochain comme toi-même ”. Aimons donc Dieu et adorons-le avec un cœur et un esprit pur […] (Lettre à tous les fidèles).
Faisons en outre de dignes fruits de pénitence. Puis, aimons notre prochain comme nous-mêmes. Et si quelqu'un ne veut pas ou ne peut pas aimer son prochain comme lui-même, qu'au moins il n'aille pas lui faire de mal, mais qu'il lui fasse du bien (Lettre à tous les fidèles).
Les frères ont deux façons de se comporter spirituellement parmi les infidèles. La première est de ne soulever ni débats ni discussions, mais d’être soumis à toute créature humaine à cause de Dieu et de se proclamer chrétiens. La seconde est, lorsqu’ils croiront qu’il plaît à Dieu, d’annoncer la parole de Dieu, pour que les infidèles croient au Dieu tout-puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, Créateur de toutes choses, au Fils, Rédempteur et Sauveur, et pour qu’ils soient baptisés et deviennent chrétiens […] (Règle de saint François).
Au n° 34 de l’encyclique Lumen fidei, la première du pontificat du Pape François, mais pensée et écrite en première instance par le Pape Benoît XVI pour compléter les encycliques qu’il avait déjà écrites sur l’espérance et sur la charité (le Pape François ajoutant des “ contributions ultérieures ” à cette première rédaction), nous lisons :
La lumière de l’amour, propre à la foi, peut illuminer les questions de notre temps sur la vérité. La vérité aujourd’hui est souvent réduite à une authenticité subjective de chacun, valable seulement pour la vie individuelle. Une vérité commune nous fait peur, parce que nous l’identifions avec l’imposition intransigeante des totalitarismes. Mais si la vérité est la vérité de l’amour, si c’est la vérité qui s’entrouvre dans la rencontre personnelle avec l’Autre et avec les autres, elle reste alors libérée de la fermeture dans l’individu et peut faire partie du bien commun.
Étant la vérité d’un amour, ce n’est pas une vérité qui s’impose avec violence, ce n’est pas une vérité qui écrase l’individu. Naissant de l’amour, elle peut arriver au cœur, au centre de chaque personne. Il résulte alors clairement que la foi n’est pas intransigeante, mais elle grandit dans une cohabitation qui respecte l’autre.
Le croyant n’est pas arrogant ; au contraire, la vérité le rend humble, sachant que ce n’est pas lui qui la possède, mais c’est elle qui l’embrasse et le possède. Loin de le raidir, la sécurité de la foi le met en route, et rend possible le témoignage et le dialogue avec tous.
Le témoignage de la vie et, lorsqu’ils croiront qu’il plaît à Dieu, l’annonce de sa parole, dans la douceur et dans le respect, sont donc les éléments fondamentaux de la mission.

