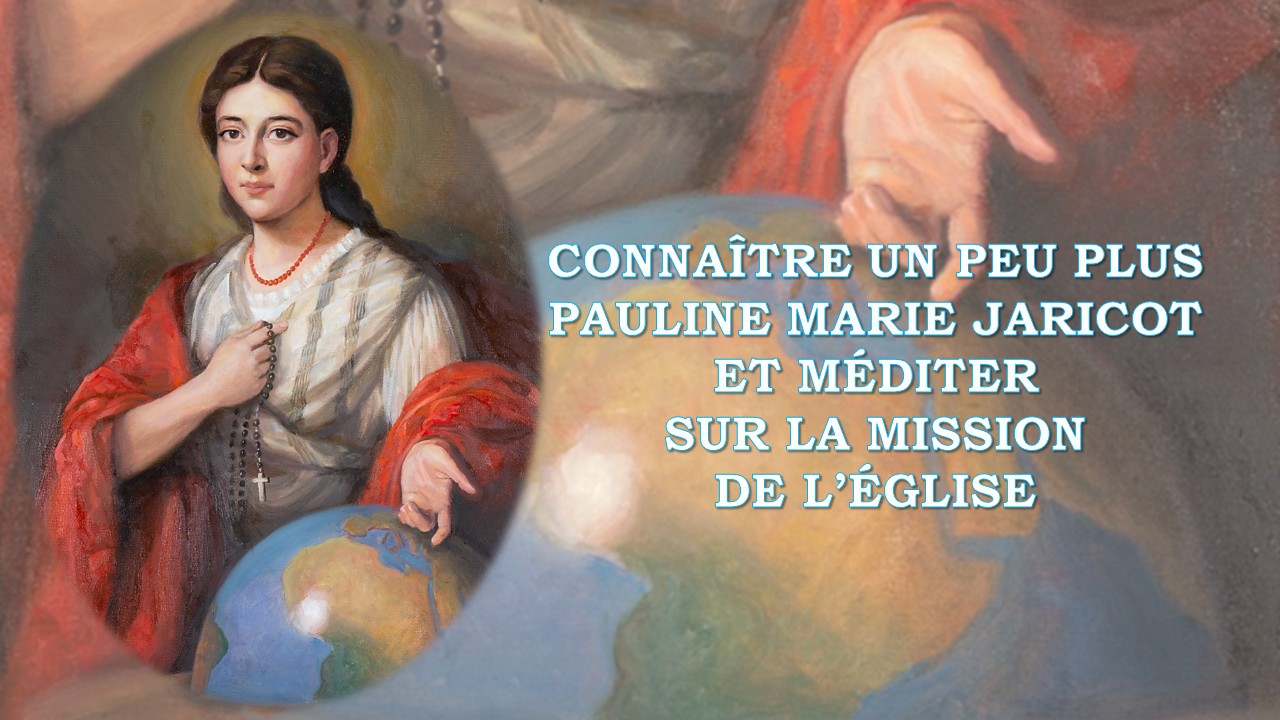
29 octobre - Pauline, la « pauvre de Marie »
En 1845 et en 1850, Mgr Emmanuel Verrolles (1805-1878), vicaire apostolique de Mandchourie, est encouragé par Grégoire XVI afin qu’il circule en Europe pour exciter le zèle des catholiques en faveur de l’Œuvre de la Propagation de la Foi. Il visite dans ce but la plupart des diocèses de France. Quand Pauline le rencontre, à Paris, ils ont de longs entretiens. Avant de repartir en Orient, il écrit à Pauline, le 17 août 1850, disant non seulement son intérêt pour l’œuvre Notre-Dame-des-Anges mais aussi l’importance de l’Œuvre de la Propagation de la Foi qui permet aux missionnaires de vivre et de travailler en Asie. Il exprime son sentiment de gratitude et la nécessité d’aider Pauline aux jours de sa détresse, causée en grande partie par sa charité. Il l’appelle « Mère de nos missions », en pensant aux missions dans le monde, en particulier en Asie. Malgré la « pénurie » qui est la sienne, il fait un don de 6 francs. Pauline, appelée ici « Mère des missions » se sent réconfortée dans le combat qu’elle mène pour être reconnue dan son rôle de fondatrice par ceux qui donnent leur vie dans les missions.
A la fin de sa vie, Pauline est pauvre, au bord de la misère, victime des escrocs, des riches et des puissants. La pauvreté ne renvoie-t-elle pas à l’humilité et à la piété. Dans le judaïsme tardif, les pauvres constituent le vrai Israël. Dans Lc 6, 24, Jésus crie malheur sur les riches et les personnes rassasiées et dans Mt 5, 3 il appelle bienheureux les pauvres en esprit, c’est-à-dire les vrais pauvres, ceux qui souffrent mais qui supportent leur pauvreté et en profitent pour s’ouvrir à Dieu. Jésus demande à ses amis, à ceux qui lui appartiennent de renoncer à la possession de biens (Mt 8, 20), à cause de la liberté que cela donne, peut-être aussi à cause de la nécessaire unité de la communauté. Mais il faut mettre tout en œuvre pour supprimer la pauvreté sur le plan social, même s’il restera toujours des pauvres dans le monde (Mt 26, 11). La pauvreté librement assumée doit être une forme de l’ascèse chrétienne et, comme toute obéissance aux conseils évangéliques, un signe de la Foi de l’Église dans la Fin des temps déjà inaugurée, qui renvoie au fondement même de l’espérance chrétienne. Il n’en demeure pas moins difficile de concilier le renoncement des individus à s’enrichir à la possession de biens par les communautés religieuses. Pour Pauline, il faut voir « combien notre orgueil met d’obstacles aux grâces de Dieu. »
En nous basant par exemple sur l’évangile de Luc, nous voyons comment le discours dans la plaine s’ouvre par le bonheur promis aux pauvres et la malédiction des riches (Lc 6, 20.24s). Avec la rupture des liens familiaux et l’acceptation de la souffrance, le renoncement aux biens s’inscrit dans la norme de la suivance. Cet appel à la suivance va de pair avec l’abandon des biens (Lc 5, 11.28 ; 9, 3 ; 10, 4 ; 18, 28). « Ainsi donc, quiconque parmi vous ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut être mon disciple » (Lc 14, 33). Il faut se convertir et adopter une nouvelle éthique. Il n’est pas difficile de pressentir dans cette insistance le souci de Luc de s’adresser à une chrétienté riche, ou plutôt, d’interpeller les riches parmi les croyants visés par son œuvre. Il faut ajouter l’insistance sur la prière, un autre trait qui singularise l’éthique de Luc.
A chaque étape importante de son ministère, Jésus prie : à son baptême, avant de choisir les apôtres, avant la profession de foi de Pierre, lors de la Transfiguration, à l’agonie et sur la croix. Ces moments-clés ne sont-ils pas repris dans les thèmes de méditation du Rosaire vivant ? Ces thèmes ont nourri la prière et la méditation de Pauline et toutes les personnes qui ont adopté le Rosaire vivant pour mieux méditer sur les mystères de notre Salut, l’engagement de Marie et de son fils en vue du salut de toute l’humanité. Luc met l’accent sur la confiance en la bonté du Père et sur la nécessité de prier sans cesse (Lc 11, 1-13 ; 18, 1-14). Prier sans relâche s’avère une nécessité pour vivre le temps de l’Église qui, selon la conception lucanienne de l’histoire, est appelée à durer longtemps.
Il faudrait, explique Pauline, « que nous fussions bien petites, bien humbles ; oui alors, nos prières offertes à la Majesté divine appelleraient sa pitié et arrêteraient son courroux. A quoi donc attribuer le peu de réussite de nos prières ? A notre orgueil, oui c’est notre orgueil qui forme l’empêchement aux effets de la prière. Le Pharisien superbe n’obtient rien, tandis que l’humble publicain s’en retourne justifié. Demandons, mes Sœurs, l’humilité, c’est-à-dire demandons le sentiment de la vérité, de notre néant, de nos péchés et de notre indignité. Dieu est vérité, quand nous sommes dans la vérité il incline son cœur vers nous et la voix du pauvre et du faible qui crient vers sa miséricorde pour lui-même et pour ses frères ne retourne point sans effet. Je demanderai à Notre Seigneur de vous inspirer de prier pour que nous entrions dans ces dispositions ; alors nous pourrons espérer que vos vœux seront agréés de notre Seigneur Jésus Christ en qui je suis toute vôtre. » (Pauline Jaricot, Le Rosaire vivant, Paris, Lethielleux, 2011, p. 203-204)
Pour le pape Léon XIII, c’est Pauline qui « organisa, après en avoir conçu les plans, la belle œuvre appelée Propagation de la Foi, une collecte immense formée de l’obole hebdomadaire des fidèles, comblée de louanges par les évêques et par le Saint-Siège lui-même qui s’étant merveilleusement développée, fournit d’abondantes ressources aux missions catholiques. C’est à elle que l’on doit aussi l’heureuse initiative de distribuer parmi 15 personnes les cinq dizaines du Rosaire. Ainsi… elle propagea de façon stupéfiante et rendit incessante l’invocation à la Mère de Dieu. De cette façon, bien vite, les Lettres pontificales recommandèrent et enrichirent de nombreuses indulgences cette nouvelle forme de prière, qui fut rapidement diffusée avec l’approbation générale. Parmi les initiatives de bien, on devrait encore à cette pieuse vierge l’initiative de l’œuvre qui a pour objectif la régénération des ouvriers, œuvre à laquelle de nos jours travaillent si utilement et avec tant de zèle les associations catholiques et à laquelle Pauline Jaricot a consacré les vastes ressources de son patrimoine. Mais une trahison infâme l’a dénuée de toutes ses richesses. » (Annexe III, Un Bref de Sa Sainteté Léon XXIII, fait à Rome, en l’église Saint-Pierre, le 3 juin 1881, dans Sœur Cecilia Giacovelli, Pauline Jaricot. Biographie, op. cit., p. 331-332).
Pauline Jaricot a su articuler, de façon harmonieuse, piété et engagement social, abandon total à Dieu, prières à Marie et à Jésus, sans oublier l’attention aux pauvres, aux ouvriers et aux petits. Elle a voulu servir Dieu, l’Église et les pauvres en même temps, en essayant d’aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée (cf. Lc 10, 27). L’amour est la voie de la vie éternelle et, comme l’a demandé Jésus, Pauline a su relier dans sa vie l’amour de Dieu et celui du prochain, celui-ci étant perçu comme toute personne qui a eu besoin d’aide. A la fin de la parabole du bon Samaritain, Jésus dit : « Va et, toi aussi, fais de même. » (Lc 10, 37) C’est ce que Pauline a compris et c’est ce qu’elle a essayé de vivre, après sa conversion et durant le reste de sa vie.

