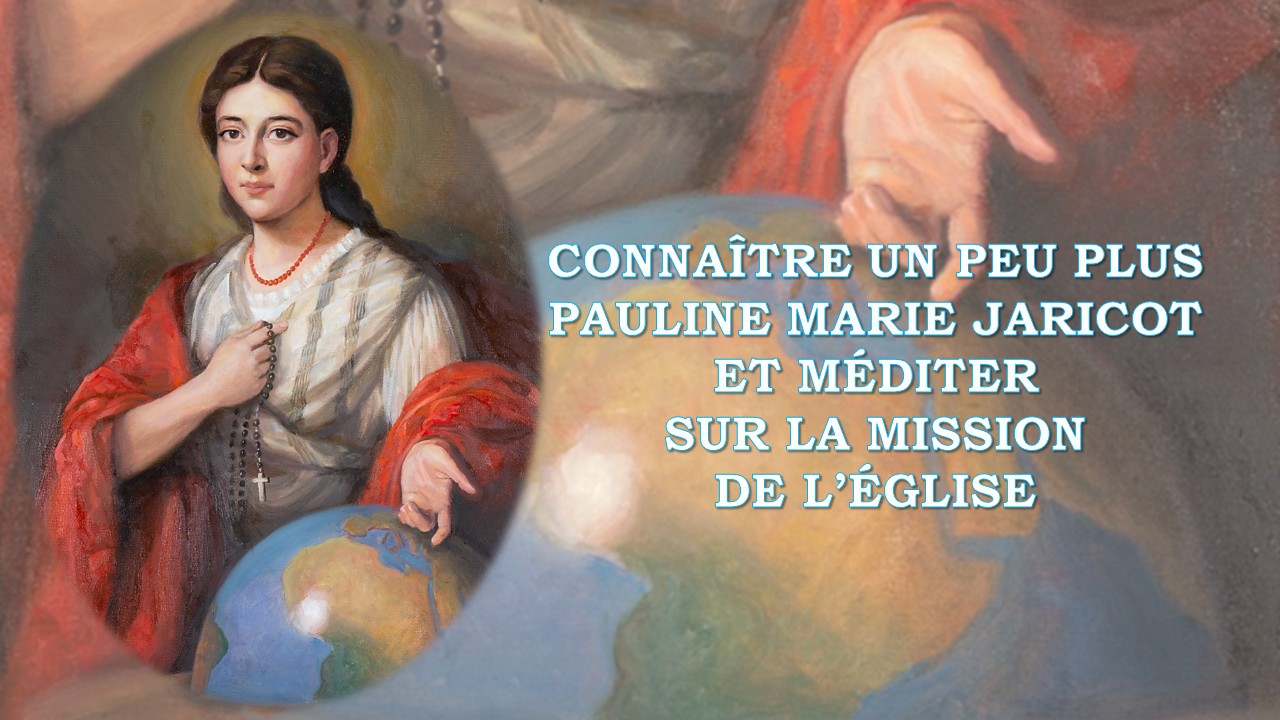
Le 18 octobre - Pauline et sainte Philomène
En voyant, à Rome, Pauline à l’agonie, le pape Grégoire XVI se recommande à ses prières « dès qu’elle sera arrivée au ciel. » Pauline lui répond : « Oui, Très saint Père, je vous le promets. Mais si à mon retour de Mugnano, j’allais à pied au Vatican, votre Sainteté daignerait-elle procéder sans retard à l’examen définitif de la cause de sainte Philomène ? » Et le pape de lui répondre : « Oui, oui, oui, ma fille, car alors il y aurait miracle de premier ordre » ! Le pape promet tout, étant sûr de n’avoir pas à s’exécuter : il dit alors en italien à la sœur supérieure, sans doute des religieuses du Sacré-Cœur de la Trinité des Monts, amies de Pauline : « On dirait qu’elle sort du tombeau. Elle ne reviendra pas." » (Catherine Masson, Pauline Jaricot, op. cit., p. 314)
De retour de Mugnano à Rome, Pauline se présente au Vatican. Le pape n’en croit pas ses yeux. Il demande à Pauline de marcher de long en large, en lui demandant des allers-retours, en rendant grâce à Dieu qui lui a fait des merveilles. « Pauline alors demande au pape de pouvoir accomplir son vœu et d’élever une chapelle à sainte Philomène. "Oui, ma fille, répond-il. Nous allons pousser l’étude de la cause". Il autorisera son culte le 13 janvier 1837. » (Catherine Masson, Pauline Jaricot, op. cit., p. 316) Grégoire XVI retient Pauline à Rome près d’une année afin que le miracle en sa faveur puisse être constaté. Pendant se séjour à Rome, Pauline a plusieurs rencontres avec Grégoire XVI auxquelles assiste presque toujours le cardinal Luigi Lambruschini, (ancien nonce de Paris devenu cardinal le 30 septembre 1831 et Secrétaire d’État en 1838, qui obtient du pape Grégoire xvi l’approbation solennelle du Rosaire vivant), rencontres durant lesquelles il est souvent question des épreuves de l’Église et des dangers de la France. Pauline profite de son séjour pour visiter avec joie la ville de Rome, le Vatican, mais aussi pour rédiger des textes, notamment son autobiographie. C’est aussi pendant cette période que le Rosaire vivant est affilié à l’ordre des Dominicains (voir Catherine Masson, Pauline Jaricot, op. cit., p. 317).
En quittant Rome, le 25 mai 1836, pour Florence et Bologne, en passant par Lorette, Pauline se promet de revenir. « Son retour à Lyon est salué comme un miracle et elle reprend son œuvre. « Pauline, qui a 37 ans, a retrouvé la santé "avec sa physionomie intelligente et pénétrée de mansuétude, ses grands yeux spiritualisés par la flamme des effusions extatiques", écrit David Lathoud, mais aussi avec "son bonnet ruchet, l’escot noir de sa pèlerine courte, son eucologe à la main, vous la prendriez facilement pour une religieuse" » (Catherine Masson, Pauline Jaricot, op. cit., p. 317).
A la maison de Lorette, Pauline charge l’abbé Rousselon de faire ériger une chapelle à sainte Philomène en reconnaissance de sa guérison sur le tombeau de la sainte. Celle-là s’élève bientôt près de la montée Saint-Barthélemy : petite chapelle d’une vingtaine de places, construite par l’architecte Antoine Chenavard (1787-1883) et qui reproduit en miniature l’église de Mugnano. Elle est inaugurée en novembre 1839. Les pèlerins peuvent y venir pour prier à toute heure sans passer par la maison ni le clos de la propriété.
Dès son retour, en 1836, Pauline fait le voyage à Ars, à une quarantaine de kilomètre de Lyon pour porter une relique de Philomène, les fragments de l’humérus. Jean-Marie Vianney admire la santé de Pauline qui lui est revenue. « Son cœur fond de reconnaissance envers Dieu pour ce prodige, mais il ne montre pas d’étonnement car il sait bien que tout est prodige de ce qui vient de Dieu. Ils restent un moment silencieux. Deux années se sont écoulées depuis leur dernière entrevue. La joie est grande chez Pauline qui attendait depuis si longtemps ce bonheur. » (Jean Barbier, Le curé d’Ars et Pauline Jaricot, Lyon, Ed. & Imprimeries du Sud-Est, 1952, p. 90-91). Le curé reçoit « les restes de la Vierge grecque avec une joie inexprimable. Il rit et pleure et dit à Pauline qu’il exposera les reliques dans son église. » (Jean Barbier, Le curé d’Ars et Pauline Jaricot, op. cit., p. 92). Cette vierge est souvent présentée comme une « princesse grecque » qui « serait venue à Rome, aurait été aimée de Dioclétien pour sa beauté, mais promise à Jésus-Christ par le vœu de virginité, se serait refusée et aurait payé son insoumission d’une mort affreuse (voir Jean Barbier, Le Curé d’Ars et Pauline Jaricot, op. cit., p. 76.) A Mugnano, sainte Philomène était surtout connue pour ses miracles et sa mort pour la foi.

