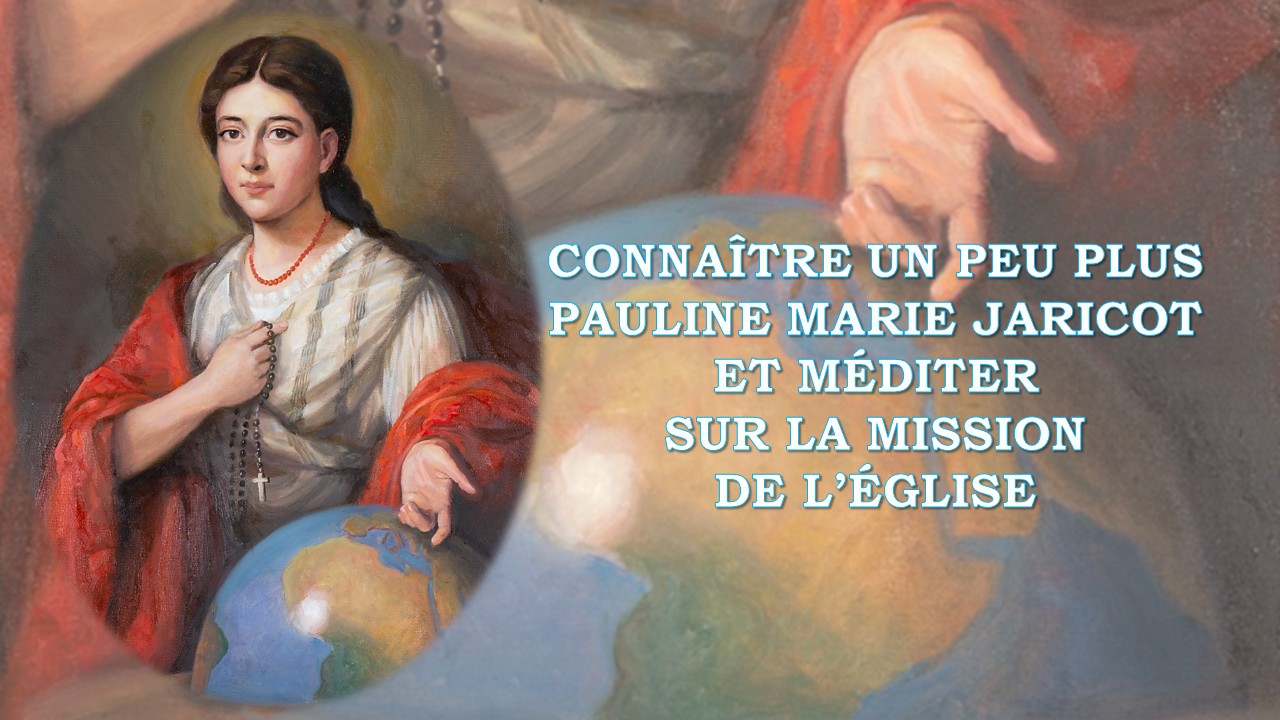
23 octobre - La famille, l’échec, la croix
Pauline Marie Jaricot a beaucoup reçu de sa famille, en matière d’éducation et d’aides de toute sorte, de son père, Antoine Jaricot, et de sa mère, Madame Jaricot née Jeanne Lattier, de ses frères et sœurs. Elle a une prédilection marquée pour sa sœur Sophie, de 9 ans son aînée et sur qui elle va s’appuyer après le décès de sa mère. Elle a plein d’affection pour Sophie. Dans une lettre du 18 mars 1823, après le mariage de sa sœur et son départ dans la capitale, Pauline lui écrit en rappelant ceci : « Il me semble que mon céleste Époux ne pouvait se fâcher de l’espèce de vide où me laissait ton départ, puisque c’est en parlant de lui que nos cœurs trouvaient l’un dans l’autre toute leur joie. Aussi, te cherchais-je les premiers jours comme un enfant qui a perdu sa nourrice. Il me semblait te voir entrer chez toi à tout moment, et, quand j’allais prier à Saint-Nizier, je pensais prier tout près de ma sœur. Quelle faiblesse ! diras-tu, sans doute, et que d’imperfections dans ton âme, ma pauvre Pauline ! Oui, j’en conviens, et je tâcherai de devenir plus sage et plus soumise ; mais les premiers mouvements seront toujours vifs quand il s’agira de ma chère nourrice (je n’ose dire de ma chère mère, car tu sais bien que je n’en ai qu’une qui est la très Sainte Vierge Marie, et que je suis jalouse d’avoir qu’elle pour Mère. » (Joseph Servel, Un autre visage. op. cit., p. 15). Comme sa sœur Sophie, elle est préoccupée par sa relation avec le Sacré-Cœur de Jésus « Oh ! ne cessons pas de le supplier de faire éclater sa puissance et sa gloire sur la terre, afin que les pécheurs tombent enfin à ses pieds et le reconnaissent pour leur salut, leur bonheur et leur vie. Les hommes sont devenus si orgueilleux, que les humiliations de la Croix, que l’Amour infini de Jésus-Christ fait bien peu d’impression sur leur cœur… » (Joseph Servel, Un autre visage, op. cit., p. 16).
Il y avait des secrets entre les deux sœurs, des zones d’intimité où les autres membres de la famille n’avaient pas accès, même si plus tard Philéas (1797-1830) va entrer dans la confidence, notamment à propos des engagements missionnaires et, de façon spéciale, après l’ordination sacerdotale le 20 décembre 1823. Sophie devait soutenir de ses deniers les initiatives que la charité inspirait à sa cadette et de son côté, Pauline devait partager quelques confidences spirituelles avec sa sœur, notamment ce qui concerne l’Eucharistie, l’Amour infini de Dieu. L’une et l’autre devaient participer au combat que leur commun directeur, l’abbé Würtz, menait alors avec quelque âpreté contre les résurgences du Gallicanisme et la « nouvelle philosophie » (voir Joseph Servel, Un autre visage, op. cit., p. 16). La foi de Pauline et son engagement à travers diverses œuvres, notamment la Propagation de la Foi et le rosaire vivant ne vont pas l’empêcher d’avoir des difficultés, des échecs et de rencontrer, sur son chemin de laïque engagée, la croix.
Pauline, héritière de son père, va obtenir les moyens financiers de racheter des propriétés, notamment à Fourvière, où elle a peur que la franc-maçonnerie s’installe ; elle en fait allusion dans ses écrits (Catherine Masson, op. cit., p. 414). « Pauline, avec sa famille, s’attache donc, pour sauvegarder l’intégrité de la colline de Fourvière, à reconquérir, progressivement tous les terrains afin d’en assurer la vocation religieuse. » Après la vente de son usine chrétienne de Rustrel, Pauline va être confrontée à une série de difficultés, des dettes et de nombreux procès. « Le total de la dette de Pauline a été évalué à environ 400.000 francs : 116.000 francs à son plus gros créancier, Boussairolles, héritier de Mlle Deydé, environ 100.000 francs pour l’ensemble des autres créanciers hypothécaires, le reste se répartissant entre tous les petits créanciers, qui ont prêté de l’argent en raison, à la fois, de la confiance qu’ils avaient en Pauline et de la réputation de l’affaire de Rustrel. » (Catherine Masson, op. cit., p. 415). Pauline est tellement ruinée qu’elle va devenir la « mendiante de Notre-Dame-des-Anges » (Catherine Masson, op. cit., p. 375), contrainte d’aller de ville en ville pour essayer de trouver le nécessaire pour rembourser ses dettes. Elle a quelques soutiens en France et hors de France, mais cela ne suffit pas. Les « démêlés » (Catherine Masson, op. cit., p. 424) qu’elle vit avec la Commission de Fourvière, créée le 7 mars 1853, constituent pour elle une source d’inquiétudes supplémentaires, car, selon Mgr Lavarenne, « les circonstances l’avaient obligée à soutenir des procès contre la Commission de Fourvière, les hommes les plus respectables, les plus sincèrement chrétiens, la considéraient avec une défiance qui allait jusqu’à l’hostilité » (Georges Naïdenoff, Pauline Jaricot, op. cit., p. 86). Pauline vit diverses difficultés auxquelles elle est confrontée dans les dernières années de sa vie comme un véritable « martyre du cœur », selon son expression (Yvonne Pirat, Pauline Jaricot, Paris, Œuvre pontificale de la Propagation de la Foi, sans date, p. 32).
L’entreprise de Rustrel avait pourtant donné de bons espoirs à Pauline. Pendant quelques mois, on vit fumer les haut-fourneaux de Notre-Dame des Anges. Au début de l’année 1848, il était permis de croire que l’entreprise pourrait se relever et contribuer à réaliser les buts humanitaires et chrétiens de Pauline Jaricot. Mais avec la révolution de 1848, les perturbations sociales, économiques et financières portent un coup mortel à l’établissement de Rustrel. Malgré sa prudence, sa demande de conseils et toutes les garanties nécessaires, Pauline est victime d’une gigantesque escroquerie savamment organisée. En mai 1852, l’usine est revendue aux enchères, le tiers de ce qu’elle avait coûté et Pauline est écrasée sous le poids d’une dette de 400.000 francs. (Yvonne Pirat, Pauline Jaricot, op. cit., p. 32) Comment rembourser à tous les petits souscripteurs de l’œuvre, ses amies les ouvrières, toutes les personnes qui avaient eu confiance en elle et avaient placé dans ses mains leurs modestes économies ? Ses amies ouvrières « ont été les premières à la consoler, à lui accorder des délais et ne se sont pas montrées aussi exigeantes que les prêteurs riches » (Yvonne Pirat, Pauline Jaricot, op. cit., p. 32). Quand elle comprend son échec, Pauline va demander conseil auprès de Mgr Villecourt, évêque de La Rochelle, qui l’a connue autrefois à Lyon, lorsqu’elle avait 17 ans et qu’il était maître spirituel à l’Hôtel-Dieu, quelques années avant Philéas. Il lui conseille de quêter d’un bout de la France à l’autre pour l’œuvre des ouvriers qu’il considère comme une œuvre d’utilité pour l’Église et qui, par conséquent, mérite d’être relevée par le budget de la charité chrétienne. L’évêque atteste dans une lettre très élogieuse le rôle de Pauline dans la Propagation de la Foi : « la pieuse fondatrice qui, après avoir tracé le plan et les bases de cette œuvre, en a laissé à d’autres la gloire, et n’a voulu pour elle que l’oubli, le recueillement et le silence » (Yvonne Pirat, Pauline Jaricot, op. cit., p. 32).
A quoi pense Pauline, en allant de maison en maison, avec des lettres de recommandations signées de prêtres et d’évêques, pour quêter ? Elle pense aux stations du Chemin de Croix. Malheureusement, certains mauvais cœurs s’emploient à empêcher l’aboutissement des bonnes idées qu’elle pourrait proposer pour retrouver les sommes perdues, d’autres opposent un refus glacial. Même si Pauline recueille d’abondantes aumônes, en France mais aussi, grâce à sa fidèle amie, Mlle Maurin, partie solliciter de l’aide à l’étranger. Pauline reçoit des dons en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Angleterre où le grand Newman accueille avec une grande sympathie les idées généreuses que représentait l’œuvre de Notre-Dame des Anges. Les dons ne suffisent pas à libérer Pauline de ses soucis écrasants. Elle n’arrive pas à rembourser ses créanciers, surtout les petits, « ses bien-aimés petits créanciers » (Yvonne Pirat, Pauline Jaricot, op. cit., p. 33). Elle craignait les dettes plus que la mort et elle donne ce qu’elle reçoit et finit par être réduite à la plus entière pauvreté que consent à partager avec elle sa fidèle Maria Dubouis. « Le 26 février 1853, elle se fait inscrire comme indigente au bureau de bienfaisance du quartier Saint-Just. » (Yvonne Pirat, Pauline Jaricot, op. cit., p. 33). Dans les derniers temps de sa vie, Pauline est confrontée à la souffrance, mais reste fidèle à la prière et à une certaine résignation. Elle prie la Mère des Douleurs, s’abandonnant à la volonté de Dieu et priant pour ses adversaires : « Obtenez à mon cœur le pardon entier et généreux pour ceux qui m’ont offensée, affligée, traversée et qui m’affligent et m’affligeront encore. Si mes douleurs sont de quelque mérite, je veux que mes ennemis soient les premiers à en recueillir les fruits pour leur salut et même pour leur bonheur temporel. » (Yvonne Pirat, Pauline Jaricot, op. cit., p. 34). Le Curé d’Ars avait raison de dire, lors d’une prédication : « Je connais, moi, une personne qui sait bien accepter les croix, des croix très lourdes, et qui les porte avec un grand amour… C’est Mlle Jaricot. » (Yvonne Pirat, Pauline Jaricot, op. cit., p. 34).
Pauline a vu partir en fumée une œuvre qu’elle aimait tant et dans l’extrême indigence, « ce désastre accumula sur sa tête les épines piquantes et cruelles que lui causèrent les créanciers, les tribunaux, les voyages à pied, les refus impolis, les trahisons, les calomnies, les désolations ; en un mot, tout ce qui est capable d’abattre le cœur le plus courageux. Dieu permettait cela, sans doute, pour que celle qui avait vécu pour Lui et pour le salut de ses frères suive, au couchant de sa vie, Jésus-Christ mourant pour le peuple qui le condamnait, et parce que, pour sa foi, sa confiance, sa force d’âme, sa douceur et l’acceptation sereine de toutes les croix, elle se montra une vraie disciple. » (Annexe III, Un Bref de Sa Sainteté Léon XXIII, fait à Rome, en l’église Saint-Pierre, le 3 juin 1881, dans Sœur Cecilia Giacovelli, Pauline Jaricot. Biographie, op. cit., p. 332).
Pauline a laissé « une sorte de testament autographe, écrit à l’ombre du tabernacle et dont voici quelques extraits : Mon espérance est en Jésus ! Mon seul trésor est la croix ! La part qui m’est échue est excellente, et mon héritage m’est très précieux ! Je bénirai le Seigneur en tout temps et sa louange sera continuellement dans ma bouche. Que la très juste, très élevée et très sainte volonté de Dieu soit accomplie en toute chose ! […] Que m’importe donc, ô volonté toute puissante et toute aimable du Sauveur, que m’importe que vous m’ôtiez les biens terrestres, la réputation, l’honneur, la santé, la vie, que vous me fassiez descendre, par l’humiliation, jusque dans le puits de l’abime le plus profond ! Que m’importe […] si dans cet abîme je puis trouver le feu caché de votre céleste amour […] Oh ! Mille fois heureuse serai-je, si je peux dire aussi en mourant pour vous, et pour mes frères : c’est pour cela que je suis née et ma tâche est consommée ! Jésus, prêtre et victime ! Hostie vivante ! Sacrifice et sacrificateur, j’unis le sacrifice de ma vie au sacrifice de la croix, l’effusion de mon sang à l’effusion du vôtre. » (Catherine Masson, Pauline Jaricot, 1799-1862. Biographie, Paris, Cerf, 2019, p. 467-468 ; voir aussi Georges Naïdenoff, Pauline Jaricot. « J’étais si vivante de ma propre vie », Paris, Médiaspaul, 1986, p. 87-88.)

