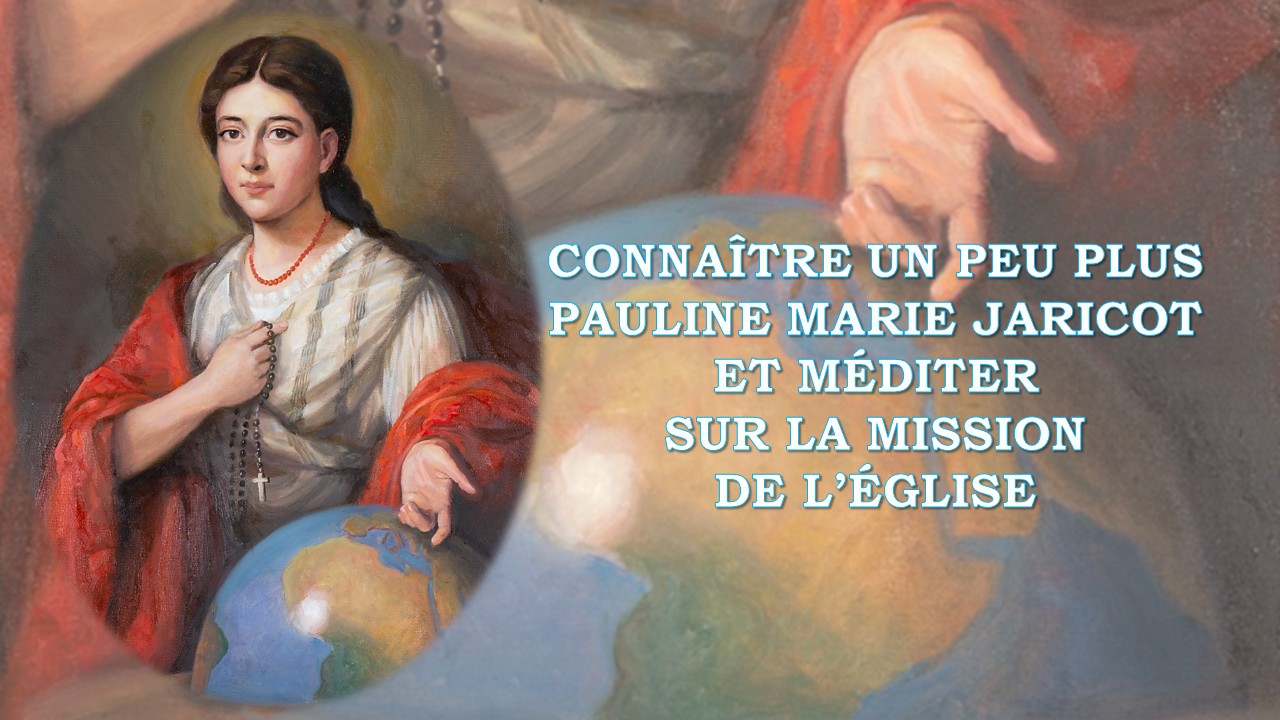
24 octobre - Pauline, Mgr de Forbin-Janson et la mission des enfants
Il est important de noter le lien particulier que vécurent Mgr de Forbin-Janson et Pauline Jaricot, car l’Œuvre de la Sainte-Enfance, aujourd’hui l’Œuvre de l’Enfance missionnaire, est l’une des quatre Œuvres Pontificales Missionnaires. Mgr Charles de Forbin-Janson (1785-1844) s’inspire de l’intuition de Pauline et de la méthode de la Propagation de la Foi pour fonder cette œuvre en direction des enfants. N’est-il pas possible de créer pour ces derniers quelque chose de semblable à ce qui est fait pour les adultes en matière d’engagement missionnaire ? Mgr de Forbin-Janson va rencontrer Pauline Jaricot et voir comment diriger son action missionnaire vers les enfants, en s’inspirant des idées qu’elle lui donnera.
Notons d’abord que l’œuvre de la Propagation de la Foi et le Rosaire vivant enthousiasment Charles de Forbin-Janson qui va prier afin qu’elles portent des fruits. Notons ensuite qu’il organise des quêtes et des prédications pour soutenir ces œuvres quand il va devenir prêtre et évêque (Catherine Masson, op. cit., p. 294 ; J. Servel, Un autre visage, op. cit., p. 204). L’évêque savait que Pauline n’était pas insensible au sort des enfants chinois. « Depuis longtemps, en effet, Mlle Jaricot était préoccupée par le salut des petits païens et cette pensée avait même été déterminante pour la fondation de la Propagation de la Foi. » (J. Servel, Un autre visage, op. cit., p. 201) Mais qui est Charles de Forbin-Janson ?
Charles de Forbin-Janson est issu d’une famille dont la fidélité au roi sera aussi importante que la soumission à l’Église. Après quelques dans l’armée de Condé, il se rallie à Napoléon et devint, au début de 1805, auditeur au Conseil d’État restauré. Il prit part aux négociations pour appliquer le Concordat et rétablir le culte en France. Alors que sa mère arrangeait pour lui un grand mariage, Charles pensait déjà au séminaire où il entra en 1808. Parmi ses confrères se trouvait le futur fondateur des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, saint Eugène de Mazenod. Leur amitié se nourrissait de leur commun désir de servir l’Église. Ils étaient préoccupés par la déchristianisation de la France après la révolution, par le manque de prêtres et, semble-t-il, par l’inadaptation d’une partie du clergé aux besoins du moment. L’Église avait de nombreux défis à relever. Alors qu’il fréquentait les prêtres des Missions Étrangères de Paris et, comme séminariste, assurait le catéchisme aux enfants de la paroisse Saint-Sulpice, il entend parler des activités des missionnaires et en particulier des missions en Chine, mais reste très préoccupé par les enfants, notamment leur préparation à la communion.
Ordonné prêtre en décembre 1811 à Chambéry, Charles de Forbin-Janson demeure préoccupé par un engagement missionnaire. Il revient à la capitale en tant que jeune prêtre, en hésitant entre le désir de rester en France et celui d’aller proposer l’Évangile en Chine. Pie VII à qui il demande conseil lui propose de venir d’abord au secours des peuples qui sont autour de lui, car il faut des missions en France. Il se joint à l’abbé de Rauzan pour fonder, en 1815, les « Missions de France », notamment à Beauvais, Angers, Nantes, en Vendée. En 1818, il accomplit une mission de sept semaines en Turquie, à Smyrne, sa première mission à l’étranger, où il fut brillant. Charles fut nommé, le 21 novembre 1823, évêque de Nancy et de Toul. Il fut sacré le 6 juin 1824, dans la chapelle du Mont Valérien, où la Mission s’était établie.
Pour diverses raisons, il ne sera pas vraiment accepté dans son diocèse. Proche du pouvoir royal, il écrit un mandement malheureux pour célébrer la prise d’Alger et provoqua une haine tenance dans les milieux franc-maçons. La révolution de juillet 1830, fut l’occasion d’une mise à sac du grand séminaire et de l’évêché. Monseigneur étant en dehors de la ville, on lui conseilla de n’y point revenir. Il partit en exil et ne verra plus jamais son diocèse. Rome va nommer successivement des auxiliaires, laissant à Mgr de Forbin-Janson le titre d’évêque de Nancy et de primat de Lorraine Le prélat va se trouver un autre ministère, à savoir la prédication, et avec Pauline, organiser autour du Rosaire vivant un groupe d’évêques et des groupes de prêtres invalides. Il va être invité aux États-Unis et au Canada où il va prêcher, entre 1838 et 1842, en rassemblant des foules jusqu’à 12000 personnes. Cet engagement missionnaire le rapproche davantage de Pauline Marie Jaricot.
Après un séjour de quatre mois à Rome durant lesquels il a décidé de renoncer à son diocèse pour ne pas s’opposer, Mgr Charles de Forbin-Janson se rend compte que sa santé lui impose l’abandon du travail d’évangélisation réalisé en Amérique du Nord qu’il a, depuis peu, eu l’honneur de soumettre au Saint-Père. Cependant, il pense s’occuper sérieusement des problèmes dramatiques de la situation des enfants en Chine. Le conseil de l’Œuvre de la Propagation de la Foi de Lyon voit cette nouvelle éventuelle nouvelle œuvre de collectes pour les missionnaires, une concurrente et non pas une section particulière de la même entité.
Le conseil manifeste donc une nette opposition au projet de Mgr de Forbin-Janson. Pauline va l’éclairer afin qu’il trouve les meilleures solutions pour réaliser ce qui lui tient à cœur (Sœur Cecilia Giacovelli, Pauline Jaricot. Biographie, op. cit., p. 230-231). Effectivement, Pauline va l’encourager à continuer son travail pour donner vie à l’œuvre de la Sainte Enfance avec l’objectif de « sauver les enfants, avec l’aide des enfants. Cette œuvre va avoir un champ d’action distinct de celui de l’œuvre de la Propagation de la Foi, mais en adoptera la méthode et l’esprit. La mission des enfants auprès d’autres enfants va stimuler et soutenir la mission et l’engagement des chrétiens adultes. Le témoignage de foi des plus jeunes peut constituer une immense richesse dans le grand plan ecclésial de la coopération missionnaire.
En fait, ce passage de Mgr Charles de Forbin-Janson à Lyon, en 1842, est très bénéfique, car l’évêque était hanté par les enfants chinois abandonnés par leurs parents. La rencontre est un succès d’autant plus que l’évêque connaissait depuis longtemps Pauline Jaricot, la fondatrice de la Propagation de la Foi. Après avoir rendu compte, à Rome, à Grégoire XVI de ses travaux d’évangélisation dans l’Amérique du Nord, il est tout heureux de faire part à Pauline de son rêve de fonder une association pour le salut de l’enfance dans les « pays infidèles » (Catherine Masson, Pauline Jaricot, 1799-1862. op. cit., p. 294-295). Il veut faire des enfants chrétiens les artisans du salut de leurs frères chinois. Ce serait la Propagation enfantine de la Foi.
Les enfants donneraient un sou par mois. Il suffit que les enfants consacrent les sous de leurs menus plaisirs pour sauver des petits frères victimes du comportement de leurs parents et à les faire vivre pour le ciel ou pour l’apostolat. C’est ainsi que l’œuvre de l’Enfance missionnaire va naître, articulée à l’œuvre de la Propagation de la Foi. Même si le rôle exact joué par Pauline, auprès de Mgr de Forbin-Janson, n’est pas vraiment connu, il est sûr que tous les deux avaient une passion pour la mission et qu’ils ont eu des influences réciproques l’un sur l’autre. Dans l’acte de constitution de l’œuvre de l’Enfance missionnaire effectué à Paris le 19 mai 1843, l’objectif affiché est de « sauver les enfants, avec l’aide des enfants » (Sœur Cecilia Giacovelli, Pauline Jaricot. Bibliographie, op. cit., p. 231).

