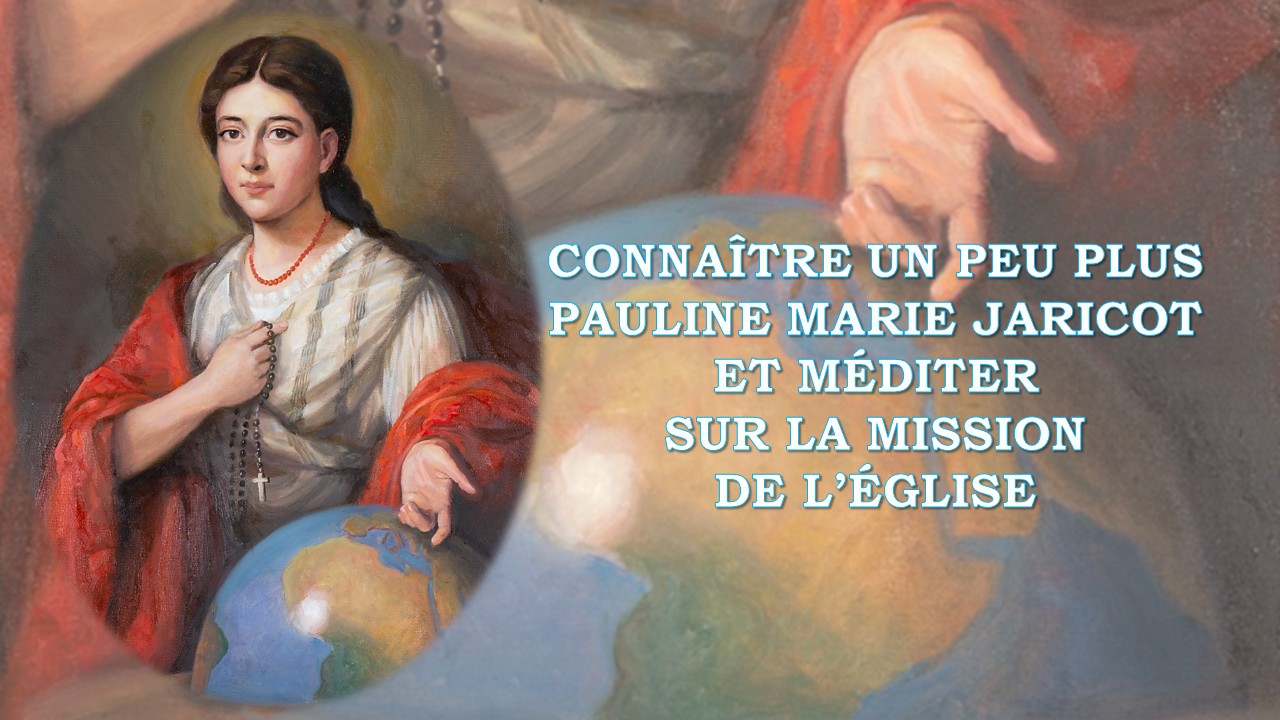
25 octobre - Endettée, Pauline refuse de vendre Lorette
L’entreprise de Rustrel où Pauline espérait redonner sa dignité à l’ouvrier est mis en vente dans des conditions misérables. Mais une nouvelle source de gains est proposée à Pauline. Il s’agit de construire un passage qui, de la montée de Saint-Barthélemy, puisse conduire à la terrasse de Fourvière : la dépense d’environ 10 000 francs serait immédiatement amortie, en faisant installer un péage de 5 centimes. Les travaux commencent après l’autorisation préfectorale, mais Pauline se retrouve face à des oppositions à la réalisation du passage vers les jardins permettant d’accéder à Fourvière. Pauline doit vendre sa maison ; la vente est prévue le 28 août 1852, mais les juges réussissent à obtenir un délai de quinze mois. Dans une lettre à Guichard du 1er décembre 1852, Pauline décrit son état d’esprit : « J’ai ressenti un terrible choc : ma maison doit être vendue le 28 août. Je vois avec douleur non pas mon propre malheur, mais celui de ceux qui, n’ayant pas une bonne hypothèque ou n’en ayant pas du tout, risquent de perdre tout leur crédit. J’ai fait un si long chemin que les juges ont compris que l’esprit de la loi puisse être en faveur des débiteurs qui désirent un peu de paix et qui, avec des retards, auraient pu raisonnablement y parvenir. J’ai obtenu quinze mois de délai pour tenter le passage. » (Sœur Cecilia Giacovelli, Pauline Jaricot, op. cit., p. 281).
Une plainte de la voisine vient atténuer la joie de Pauline juste au moment où s’achève la construction des marches de l’escalier. Si la plainte de la voisine est entendue, il faudrait démolir la rampe de l’escalier et envisager une reconstruction différente. Mais où trouver l’argent pour faire face à tant de dépenses ? Compte tenu des difficultés économiques de la Maison de Lorette, l’entrepreneur est tenté d’abandonner le projet, mais Pauline « animée par une volonté inaltérable dans les bonnes œuvres, essaie de continuer à avancer avec foi. Sa belle-sœur vient à elle avec un prêt et lui permet d’inaugurer le passage pour le sanctuaire de Notre-Dame de Fourvière le 8 décembre 1852, fête de l’Immaculée Conception » (Sœur Cecilia Giacovelli, Pauline Jaricot, op. cit., p. 281). Le public y accourt en masse et Pauline récolte assez vite 180 francs, puis 90 autres francs et à la fin du vingt-cinquième jour, le montant atteint 900 francs. Les recettes pour le droit de passage, échelonnées sur plusieurs années, pourraient permettre le remboursement total des dettes contractées pour la fabrique de Rustrel. Les personnes amoureuses de la vieille ville de Lyon apprécient l’initiative de Pauline, car elles peuvent profiter du passage « pour accéder à la vision panoramique spectaculaire qu’offre la colline de Fourvière » (Sœur Cecilia Giacovelli, Pauline Jaricot, op. cit., p. 282).
De nouvelles plaintes contre Mlle Jaricot sont déposées. Ne pouvant parvenir à un accord, Pauline est contrainte de se soumettre à une nouvelle procédure judiciaire. La maison de Lorette devient un lieu où règne la misère. Les filles de Marie vont abandonner le siège central du Rosaire vivant ; seules Marie Dubouis et Marie Melquiond et ue troisième amie restent auprès de Pauline. » Réduite à la misère, Pauline obtient le « certificat d’indigence » de la mairie de Lyon dont elle a fait la demande auprès du révérend père Godind, prêtre de Saint-Just et vice-président du XIe comité du Bureau de bienfaisance. « Pauline l’accueille comme titre de noblesse auquel elle s’attache tellement qu’elle exprime une fierté joyeuse, qui évoque sainte Claire d’Assise. » (Sœur Cecilia Giacovelli, Pauline Jaricot, op. cit., p. 283).
Pauline se bat pour garder sa maison et le 5 novembre 1853, elle peut écrire dans une lette : « Je suis presque certaine que la maison et le sentier ne seront pas expropriés, grâce à la souscription d’un délai de quatre ans pour les premières hypothèques, qui sont leur capital sur le point d’être considérablement diminué par la vente privée de deux propriétés dont je n’avais absolument pas besoin et par l’indemnité reçue à cause des dommages subis en 1848 par environ 300 voraces… » (Sœur Cecilia Giacovelli, Pauline Jaricot, op. cit., p. 283). Les fonds de la recette quotidienne du passage et d’autres intérêts qui proviennent des biens immobiliers dont Pauline est propriétaire vont convaincre la majorité des créanciers de se limiter à un remboursement progressif et de rentrer en possession de ce qu’ils ont investi dans la fabrique de Notre-Dame des Anges. Ainsi, « Pauline apprend à s’en remettre complètement à la Providence. Elle est convaincue d’y trouver le manteau qui protège les pauvres, en payant par la prière, et y découvre une sorte de miracle perpétuel de prospérité évangélique. » (Sœur Cecilia Giacovelli, Pauline Jaricot, op. cit., p. 284).
La commission de Fourvière, « créée dans le but de sauvegarder la colline et d’y construire un nouveau sanctuaire marial » (Catherine Masson, op. cit., p. 405), voudrait acheter la Maison de Lorette, mais d’autres personnes intéressées par l’accroissement de leurs affaires de spéculation, souhaitent également acquérir à un prix misérable cette Maison (100 000 francs, à la place des 400 000 demandés par Pauline qui lui auraient permis de dédommager ses plus importants créanciers hypothécaires et d’assurer à tout à prix le merveilleux piédestal naturel de l’imposant sanctuaire ; voir Sœur Cecilia Giacovelli, Pauline Jaricot, op. cit., p. 286). Malgré les médisances et les calomnies, faisant passer Pauline pour une personne qui s’est enrichie avec l’argent des collectes et qui maintenant le dilapide au point de devenir avide et de rejeter les bonnes propositions pour la mise en vente de la Maison de Lorette, car elle aspire à des possibilités plus lucratives, Pauline tient bon. Si elle s’est détachée de tout, elle a surtout redoublé son amour pour la justice et la vérité, pour Dieu qui les incarne.
Réduite à de pénibles conditions de santé et accablée du poids harassant d’une montagne de dettes, Pauline oppose cependant un net refus à toute occasion de vente de sa maison, pour une seule et invariable raison : « Si l’on veut payer toutes mes dettes, tant hypothécaires que chirographaires, je suis disposée à tout abandonner et à me retirer, bien contente d’avoir pu m’acquitter de cette œuvre de justice. Autrement, je compte sur Dieu et ne consens à rien. » (Sœur Cecilia Giacovelli, Pauline Jaricot, op. cit., p. 288). Tant pis si elle apparaît comme une personne « incapable, orgueilleuse et obstinée » (Sœur Cecilia Giacovelli, Pauline Jaricot, op. cit., p. 289). Malgré l’intervention du Saint-Père que Pauline Marie Jaricot est allée solliciter et celles du cardinal vicaire Costantino Patrizzi et l’archevêque de Lyon, A. Terret, président du conseil de l’Œuvre de la Propagation de la Foi, refuse de venir en aide à Pauline, car il s’agirait de détourner une part des fonds, de la destination spéciale pour laquelle les associés les confient au conseil de la Propagation de la Foi. Après diverses autres difficultés, Pauline va finalement réussir à garder sa Maison jusqu’à sa mort.

