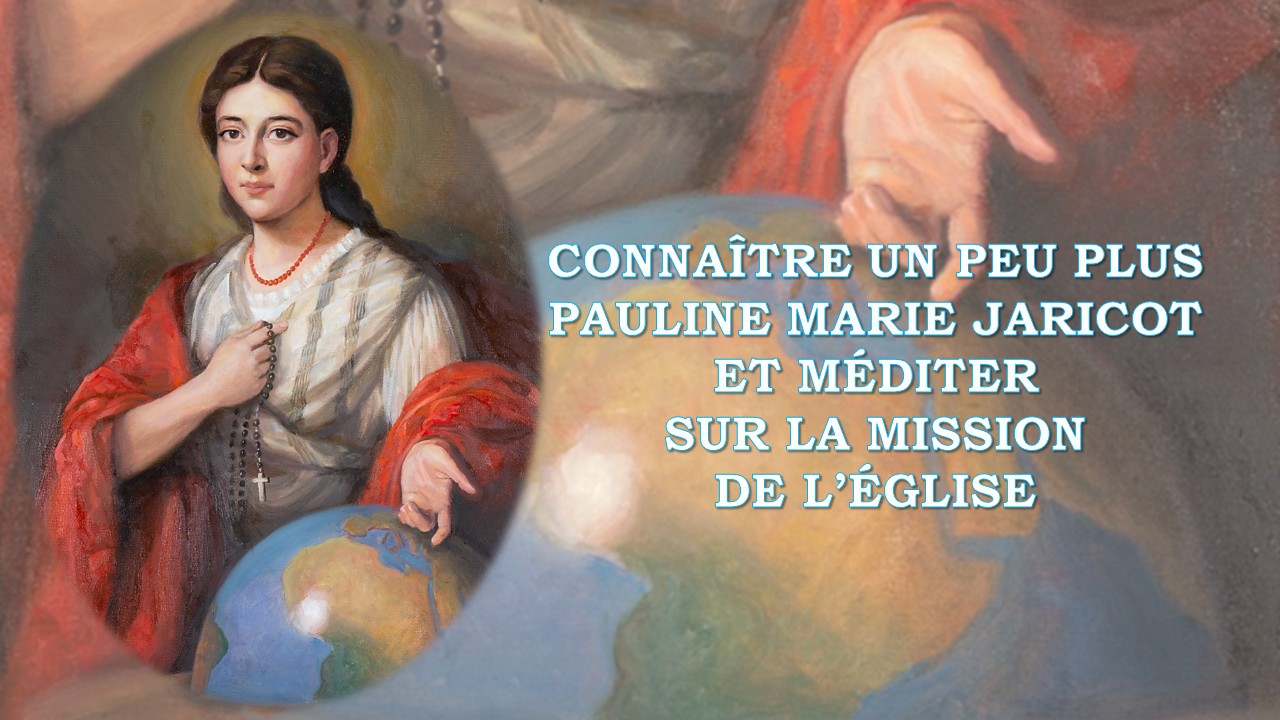
26 octobre - De l’intuition à la réalisation de l’Œuvre de la Propagation de la Foi
Quand le concordat rétablit la paix religieuse en France et entre en application (1801-1802), l’intérêt pour les missions gagne une grande partie des populations françaises. Chateaubriand (1768-1848) publie Le Génie du christianisme, revalorise le passé chrétien en donnant une grande place aux missions lointaines, et l’ouvrage est lu et relu par ceux qui seront les artisans du renouveau missionnaire : Mazenod, Forbin-Janson, etc. Le missionnaire devient ce personnage romantique, cet aventurier de la foi que les revues missionnaires vont exalter jusqu’à une période récente. Un large public s’intéresse aux récits de mission en Chine et en l’Amérique latine. C’est dans cette ambiance que les deux derniers enfants de la famille Jaricot, Philéas, né en 1797, et Pauline Marie, née en 1799, se passionnent pour les missions. Ils veulent s’engager et soutenir les missionnaires. A Philéas qui voudrait aller en Chine, Pauline exprime son souhait de le suivre. Philéas lui répond que ce n’est pas pour les filles : « Pauvrette, tu peux pas, mais tu prendras un râteau, tu ramasseras des tas d’or, tu me les enverras » (Jean Comby, « Pauline Jaricot et les missions », dans Documents Épiscopat N°6/2013 sur Pauline Marie Jaricot, Une Œuvre d’amour, publié par le Secrétariat Général de la Conférence des Évêques de France, p. 17).
A partir de 1815, l’intérêt pour les missions lointaines s’amplifie dans l’opinion chrétienne française. L’appel à s’engager pour la mission ne vient pas d’abord des responsables ecclésiastiques de la vieille Europe mais des laïcs. Les responsables de l’Église donnent la priorité à la mission intérieure. « Nos Indes sont ici », répondent les évêques français à une demande de prêtres pour les colonies (1815). « Nous pouvons nous regarder comme un pays de mission », dit l’évêque de Troyes en 1822, « hélas, plût à Dieu que la France pût être aussi facilement convertie que l’ont été le Canada et la Louisiane et autres contrées sauvages » (Jean Comby, in Documents Épiscopat, op. cit., p. 17.) En 1817, les Missions Étrangères de Paris, engagées dans l’évangélisation de l’Asie, fondent une « Association de prières pour demander à Dieu la conversion des infidèles, la persévérance des chrétiens qui vivent au milieu d’eux et la prospérité des établissements destinés à propager la foi » (Documents Épiscopat N°6/2013 sur Pauline Marie Jaricot, p. 17). Dans le terme « propager la Foi », repris dans l’indult de reconnaissance de Rome, la notion de « Propagation de la Foi » apparaît. En effet, le pape Grégoire XV fonde en 1622 la Congrégation De Propaganda Fide, Congrégation pour la Propagation de la Foi ou de la Propagande. Le pape donne à cette nouvelle congrégation les pouvoirs les plus larges dans le domaine de l’évangélisation, même si son action va demeurer limitée tant que durèrent les patronats (Voir Jean Comby, Deux mille ans d’évangélisation. Histoire de l’expansion chrétienne, Paris, Desclée, 1992, p. 112-113). Pauline Jaricot va s’engager dans ce sens, après sa conversion, à 17 ans, alors qu’elle était très soucieuse de bien paraitre en société. Elle quitte ses mondanités et mène une vie modeste. Elle décide de se consacrer totalement à Dieu tout en restant laïque et de se lancer dans les « bonnes œuvres », au sens positif des termes. Elle fonde une Association des réparatrices du cœur de Jésus, la notion de réparatrice étant très à l’honneur à cette époque. Par l’intermédiaire de son frère Philéas, alors présent à Paris et espérant partir en Chine, Pauline s’intéresse aux Missions étrangères et à cette nouvelle association qui cherche des fonds.
A partir de 1818, Pauline décide de quêter à Saint-Vallier dans la Drôme auprès des ouvrières de l’usine de son beau-frère, puis à Lyon, auprès de femmes le plus souvent généralement modestes, le plus souvent des ouvrières en soierie. Elle demande un sou par semaine, idée qui semble venir d’Angleterre. Pauline associe prière pour les missions et engagement financier. Vers la fin de l’année 1819, Pauline a une « illumination » : chaque personne doit trouver dix associés donnant un sou chaque semaine pour la Propagation de la Foi. Les personnes de confiance pourraient recevoir de dix chefs de dizaines la collecte de leurs associés, puis un chef réunissant les collectes de dix chefs de centaine pour verser le tout à un centre commun.
Pauline a l’idée de rationaliser la collecte afin qu’elle soit plus productive. L’idée de créer une organisation pour récolter de l’argent en faveur des missions, notamment celles d’Amérique, circule à Lyon. La congrégation des messieurs, issue des congrégations mariales créées par les jésuites dans leurs collèges, est fondée en 1802 à Lyon, par des jeunes gens et avec l’aide d’un père de la foi, Pierre Roger qui deviendra jésuite. Elle va rassembler des jeunes qui se tournent vers les œuvres de charité et progressivement vers les missions. Avec la venue à Lyon de Mgr Dubourg, évêque de la Louisiane aux États-Unis, les jeunes gens trouvent une nouvelle occasion d’agir, en particulier Victor Girodon, ami de Pauline et Benoît Coste, préfet ou directeur de la congrégation des messieurs. Benoît Coste répond au vicaire général (1819-20) qui le presse de fonder une association pour les missions d’Amérique : « Au lieu de toutes les associations particulières, ne vaudrait-il pas mieux se borner à en ériger une seule pour toutes les missions catholiques du monde entier, c’est-à-dire pour toutes les Missions existantes à l’époque qui ne sont pas encore si nombreuses. » (Jean Comby, in Documents Épiscopat, op. cit., p. 18-19).
La première réunion officielle de la nouvelle association, qui prend le nom d’Association (Œuvre) de la Propagation de la Foi, a lieu le 3 mai 1822. « Elle ne regroupe, excepté l’abbé Inglesi, représentant Mgr Dubourg, que les membres de la Congrégation des messieurs et si Pauline n’apparaît pas, Victor Girodon peut être considéré comme le porte-parole de son amie, défendant son point de vue. A l’époque, il aurait été extraordinaire de voir une femme siéger dans un conseil de ce type – Mme Petit ne siège pas non plus, mais son fils. En revanche, et c’est déterminant, le système de Pauline pour la récolte des fonds est adopté. Cela n’a pas semblé choquer Pauline qui, absente alors de Lyon, accepte bientôt la fusion de sa propre association avec la nouvelle fondation en lui transférant les fonds qu’elle avait reçus. » (Jean Comby, in Documents Épiscopat, op. cit., p. 19 ; voir Catherine Masson, op. cit., p. 139-140) Il faut noter qu’il s’agit d’une action de laïcs.
Même s’il faut noter qu’il y avait, en ce XIXe siècle, des hommes et des femmes fondateurs d’œuvres, il n’y a pas d’œuvre de l’importance de la Propagation de la Foi qui ait réussi à garder son indépendance aussi longtemps, même si elle travaille en lien avec la Congrégation de la propaganda fide, jusqu’en 1922, date à laquelle elle devient pontificale avec deux autres œuvres, la Sainte Enfance, aujourd’hui l’Enfance missionnaire fondée à Paris, en 1843, par Mgr de Forbin-Janson et l’œuvre de Saint Pierre Apôtre créée à Caen, en France, en 1889 grâce à Jeanne Bigard et sa mère Stéphanie. Une quatrième, l’Union pontificale missionnaire (UPM), sera créée plus tard, en 1916 à Parme (Italie), par Paolo Manna (1872-1952), et viendra en 1956, compléter le nombre des Œuvres pontificales missionnaires.

