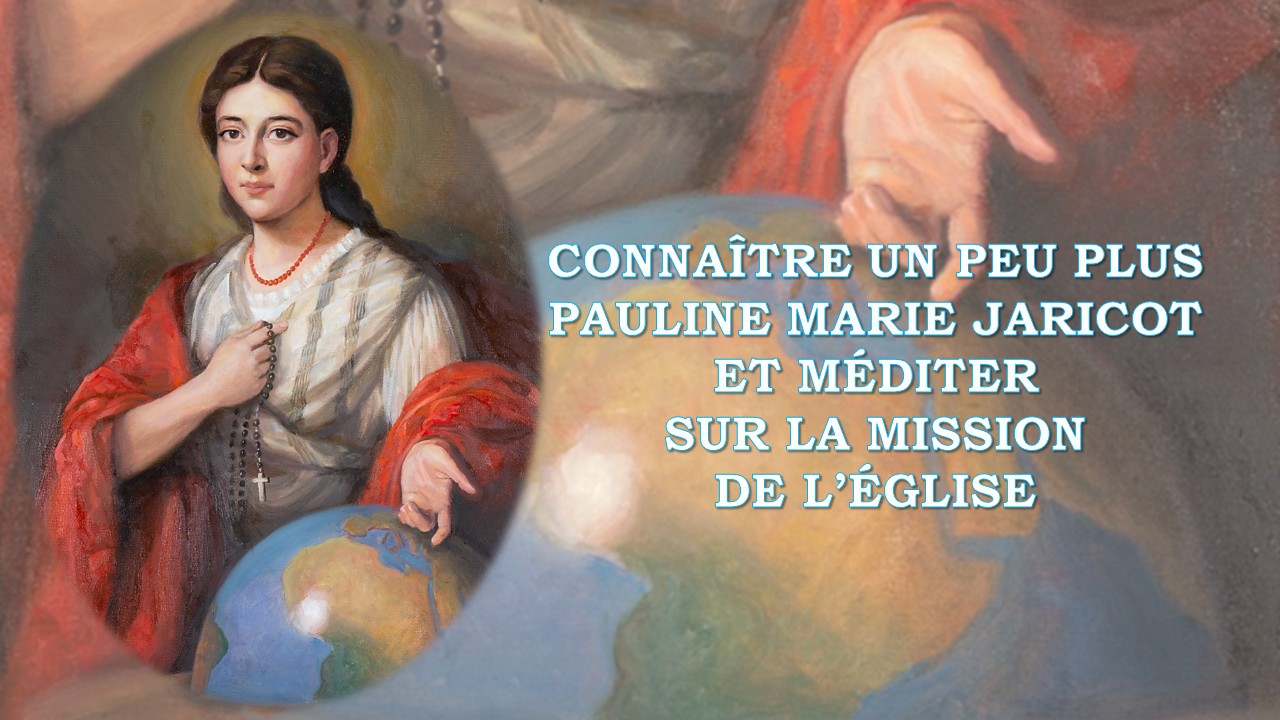
8 octobre – 1826. Le Rosaire vivant
C’est en 1826 que Pauline Marie Jaricot crée le Rosaire vivant. Celui-ci et la Propagation de la Foi sont les deux œuvres majeures de Pauline. Lorsque celle-ci lance le Rosaire vivant, elle prend modèle sur la Propagation de la Foi fondée quelques années plus tôt. Ce renouveau de la pratique du Rosaire est surtout une œuvre d’évangélisation. Pauline apparaît comme apôtre et elle veut susciter des apôtres. Pour Pauline, le Rosaire vivant « est pour le commun des fidèles et comme on les appelle dans mon pays : les chrétiens à gros grains, afin de les amener à Marie par des liens de rose. » (Pauline Jaricot, Le Rosaire vivant. Cette harpe vraiment divine, Paris, Lethielleux, 2011, p. 19.) Elle veut mettre en œuvre une pratique qui soit à la portée de tous, une sorte de « bréviaire des pauvres » comme on appelle parfois le Rosaire vivant, avec trois objectifs : faire prier ceux qui ont du mal à prier ; lutter par la prière contre les maux qui atteignent la société ; et constituer des foyers de communion missionnaire.
Il faut prier certes, mais prier ensemble pour entraîner d’autres dans la prière et le renouveau de la vie. « Car, là où deux ou trois se trouvent réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux » (Mt 18, 20) Le Rosaire vivant est une nourriture solide par la méditation des mystères du Christ, les mystères du Salut. Pour Pauline, tous les biens lui sont venus par le Rosaire vivant, notamment « l’humiliation du cœur et la prière fondée sur la confiance envers les mérites du Fils de Dieu ». C’est ainsi qu’elle a obtenu le « règne de la paix » dans son âme. Par la pratique du Rosaire, explique Pauline, « mon esprit s’est plus spécialement détaché de tous les raisonnements de la sagesse des hommes, pour ne plus espérer de salut pour l’univers que dans les mystères de la vie et de la mort d’un Dieu fait homme et victime de sa charité. Par la vertu du St Rosaire, mon cœur a osé unir sa voix à celle d’un Dieu Sauveur dont les larmes, la pauvreté, les souffrances n’ont cessé de faire retentir les demandes du Pater. » (Pauline Jaricot, Le Rosaire vivant, op. cit, p. 19-20.)
C’est en fait l’Évangile qui est sur les lèvres avec la prière du Rosaire : la salutation angélique, la prière du Seigneur, l’Évangile que l’on rumine à la travers les mystères joyeux, lumineux, douloureux et glorieux. A travers le Rosaire vivant, Pauline apparaît comme une laïque missionnaire avec d’importants talents d’organisatrice, soucieuse d’utiliser une bonne pédagogie de la Foi. Elle révèle son visage de maitresse de vie spirituelle qui partage les fruits de sa contemplation, de sa méditation sur les mystères du Rosaire, de l’œuvre du Salut. Le Rosaire apparaît comme un résumé de l’Évangile. L’objectif, c’est de multiplier les groupes du Rosaire vivant, de réveiller la foi comme au temps de saint Dominique et de réaliser des œuvres de salut. Il est donc important de connaître le Rosaire vivant et de bien percevoir le lien qu’il établit entre prière et mission, d’une part et, d’autre part, entre méditation de l’Évangile et communion ecclésiale.
Dans les pages suivantes, il va être question du l’organisation du Rosaire vivant, de ce que l’on peut présenter comme son manuel et comment il peut apparaître comme un véritable outil d’apostolat. La manière de méditer les mystères du salut, en ayant les yeux fixés sur Jésus et Marie, et en s’inspirant des exercices d’Ignace de Loyola, peut permettre aux personnes qui pratiquent le Rosaire vivant de se nourrir spirituellement et de grandir en sainteté. L’amour pour le Christ qui consumait Pauline va la pousser à prier, à agir et à aider d’autres personnes à entrer dans la même dynamique de l’amour : « Le désir d’aimer, la soif dévorante de posséder mon Dieu, me faisait désirer aussi d’agir pour sa gloire. Je sentais que celui m’enivrait de ce fleuve d’amour demandait quelque chose de ma part…. J’avais toujours un pressentiment secret qui me disait : "Dieu veut que tu serves à sa gloire ! tu es réservée à remplir des desseins cachés". » (Pauline Jaricot, Le Rosaire vivant, op. cit., p. 17)

